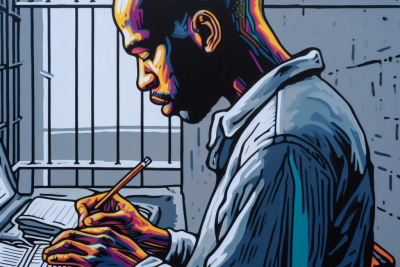Tech (1313)
Alors que le numérique prend de l'ampleur à travers le monde, le gouvernement tchadien multiplie les mesures fortes pour rattraper le retard accusé dans le secteur. De nombreuses initiatives sont en cours et les résultats sont déjà perceptibles.
Le Tchad et le Maroc vont désormais étendre leur coopération bilatérale dans le domaine des technologies de l’information et de la communication (TIC). Un mémorandum d'entente d'assistance technique a été signé, à cet effet, entre l’Agence tchadienne de développement des technologies de l’information et de la communication (ADETIC) et l'Agence nationale de réglementation des télécommunications (ANRT) du Maroc.
La collaboration prévoit entre autres la formation des ingénieurs de l’ADETIC et l'échange d'expériences entre les deux structures. L’objectif est d’aider le Tchad à adapter et implémenter le modèle marocain des TIC en faveur de l’accélération numérique dans le pays, en vue d’une économie numérique prospère.
Le partenariat entre les deux agences chargées de la régulation et de la réglementation du secteur des télécoms s’inscrit dans le cadre des actions menées par le gouvernement tchadien pour rattraper le retard accusé dans le secteur du numérique. Il est intervenu à l’issue d’une mission d’imprégnation de trois jours effectuée par une délégation de l’ADETIC au Maroc, notamment au sein de l’Agence de développement du digital (ADD) et à ARNT.
« L’essentiel des échanges ont porté sur le modèle marocain de transformation digitale de l'Administration publique, le cadre juridique et réglementaire, la gestion des infrastructures techniques des TIC ainsi que la gestion de nom du domaine et la fourniture des services universels », a déclaré l’ADETIC sur Facebook.
Grâce à ce nouveau partenariat, l’ADETIC pourra profiter de l'expérience de l'ARNT qui a déjà 25 ans d'exercice dans la réglementation du secteur des télécommunications, l'agrément des équipements de télécommunication, la gestion des noms de domaine « .ma », le traitement de la certification électronique entre autres.
Samira Njoya
Lire aussi :
L’Egypte et le Tchad souhaitent collaborer sur plusieurs projets numériques
Depuis quelques années, les start-up prolifèrent sur le continent africain. Pourtant, dans de nombreux pays, les autorités ne font pas le nécessaire pour faciliter leur croissance. Kampala a décidé de se pencher sur la question.
L’Ouganda envisage la mise en place d’une politique nationale pour les start-up. Le projet, mené par la Private Sector Foundation Uganda (PSFU), est soutenu par la Fondation Mastercard et coordonné par le ministère ougandais du Commerce, de l'Industrie et des Coopératives. L’objectif de la politique est de régir les interactions entre le gouvernement, les incubateurs, les start-up et les investisseurs dans le but de promouvoir une culture d'innovation et d'entrepreneuriat dans le pays.
« Plusieurs multinationales viennent ici et bénéficient de plusieurs privilèges de facilitation des affaires, alors que pas grand-chose n'est fait pour les start-up locales. Nous croyons qu'avec cette politique, les start-up ougandaises auront une chance de concurrencer favorablement sur le marché, car elle établira non seulement ce dont elles ont besoin, mais aussi comment obtenir du soutien », ajoute Keneth Twesigye, responsable des politiques chez Startup Uganda.
L’écosystème technologique est en plein essor sur le continent. Les start-up africaines attirent des investisseurs du monde entier mais pour diverses raisons, la plus importante part des fonds est investie au Nigeria, en Afrique du Sud et au Kenya. Dans le rapport intitulé « Venture Capital Activity in Africa Q3 2023 » publié par l'Association africaine de capital-investissement et capital-risque (AVCA), plus de 2,95 milliards $ ont été investi dans les start-up africaines pendant les 9 premiers mois de l’année.
L’Ouganda fait bien d’assainir son écosystème technologique. D’ailleurs, il faut remplir un certain nombre de conditions pour être catalogué comme une start-up dans le pays. Il faut, entre autres, avoir une structure de gestion temporaire, consacrer une partie de son budget à la recherche et au développement, être détenue majoritairement par des Ougandais et être incorporée localement en Ouganda.
Adoni Conrad Quenum
Lire aussi :
Ouganda : le gouvernement a lancé le déploiement des plaques d'immatriculation numériques
En Afrique, l'évolution des méthodes utilisées par les auteurs d'infractions oblige les forces de police à améliorer leurs capacités pour pouvoir lutter contre la cybercriminalité.
Les Seychelles ont désormais un laboratoire de criminalistique numérique visant à intensifier la lutte contre les menaces informatiques dans le pays. L’équipement a été remis le lundi 13 novembre à l’unité de lutte contre la cybercriminalité de la police par Mu Jianfeng (photo, à gauche), le chargé d'affaires de l'ambassade de Chine aux Seychelles, a-t-on appris de Seychelles News Agency.
Selon l'agence d'information, le laboratoire est financé par le gouvernement chinois à hauteur d’un million de Yuan (137 000 $).
« Le laboratoire sera pleinement opérationnel dans les prochains jours et ses principales fonctions comprennent l'extraction sécurisée des données, la sauvegarde des supports de stockage, l'acquisition rapide des données, l'analyse et l'authentification des données, ainsi que la récupération des données. Il constituera un outil efficace pour la police seychelloise et les autorités compétentes en matière d'enquête sur les données numériques et de collecte de preuves », a déclaré M. Jianfeng.
Le nouveau laboratoire arrive au moment où le gouvernement seychellois multiplie les mesures pour répondre à une montée croissante de la cybercriminalité dans le pays. En novembre 2021, une nouvelle loi sur la cybercriminalité et autres délits connexes est entrée en vigueur dans le pays après avoir été approuvée par l'Assemblée nationale.
En janvier, la mise en place d’une unité de lutte contre la cybercriminalité avait également fait l'objet de discussions entre les forces de police seychelloises et une délégation d'Interpol.
A travers cette acquisition d’équipements techniques et la formation des ressources humaines pour lutter contre la cybercriminalité, les Seychelles pourront sécuriser leurs systèmes d’information qui sont une composante indispensable pour la transformation numérique.
Samira Njoya
Lire aussi :
Depuis quelques années, les plateformes d’éducation à distance s’imposent comme des alternatives intéressantes au système éducatif traditionnel. Les autorités tanzaniennes ont décidé d’allier les deux systèmes.
Snapplify, une start-up sud-africaine qui fournit des manuels scolaires en ligne, a annoncé le vendredi 10 novembre son partenariat avec l’Institut tanzanien pour l’éducation (TIE). Le but est d’améliorer la disponibilité et la qualité des ressources éducatives pour les étudiants en Tanzanie durant les trois prochaines années.
« Notre partenariat avec TIE reflète notre vision commune de l'utilisation de la technologie pour démocratiser l'accès à l'éducation. En fournissant aux étudiants un écosystème d'apprentissage numérique complet, nous espérons susciter l'amour de l'apprentissage et encourager l'excellence académique chez les jeunes Tanzaniens », a indiqué Stephen Bestbier, responsable des partenariats gouvernementaux chez Snapplify.
The TIE has recently joined forces with @Snapplify to roll out the Tanzania e-Library Project. This initiative aims to enhance the accessibility and quality of educational resources for 11 mil students across Tanzania. Read more here: https://t.co/oc24gua9Ox#edtetch #snapplify pic.twitter.com/5BeL1R9wLn
— Snapplify (@Snapplify) November 14, 2023
Ce partenariat s’inscrit dans le cadre du projet de la bibliothèque électronique où plus de 11 millions d'élèves et 190 000 enseignants recevront un compte Snapplify personnalisé, ce qui leur permettra d'accéder à un large éventail de ressources éducatives provenant de diverses plateformes partenaires. Les contenus de la start-up, accessibles sur son application mobile et sa plateforme web, peuvent être consultés hors ligne après téléchargement depuis un ordinateur ou un smartphone.
Toutefois, il faut souligner que l’option des edtech comme solution aux problèmes éducatifs est revenue sur le devant de la scène lors de la pandémie de la Covid-19. Les plateformes d’éducation en ligne ont été de plus en plus fréquentées et elles ont aidé à résoudre divers problèmes d’éducation sur le continent, en l’occurrence ceux de la gestion des effectifs pléthoriques dans les salles de cours ou encore de l’accès aux manuels scolaires. Pour rappel, le nombre d’internautes en Tanzanie s’élève à 15,6 millions et le taux de pénétration de l’Internet est de 25 % en 2022, d’après les données de DataReportal.
Adoni Conrad Quenum
Lire aussi :
Afrique du Sud : Snapplify crée une place de marché pour les documents éducatifs numériques
La République de Djibouti vient de rejoindre le cercle fermé des pays africains à avoir leurs propres satellites dans l’espace. Parmi ces pays se trouvent le Kenya, le Zimbabwe, l’Egypte, l’Ouganda et l’Angola.
La République de Djibouti a lancé avec succès son premier satellite, Djibouti 1A, le samedi 11 novembre, depuis la base spatiale de Vandenberg, en Californie, aux Etats-Unis d’Amérique. Le satellite a décollé à bord de la fusée Falcon 9 de SpaceX.
Moment historique ce soir avec le décollage réussi de DJIBOUTI-1A, notre premier satellite. Djibouti entre dans une ère spatiale, contribuant à la collecte de données cruciales pour notre nation. #djibouti #SpaceX pic.twitter.com/0yCUGaMtcO
— Ismail Omar Guelleh (@IsmailOguelleh) November 11, 2023
« Nous avons mis en place tous les éléments nécessaires pour réussir ce projet : premièrement, la sélection d'étudiants djiboutiens, parce que l'objectif était de faire le satellite mais pas de l'acheter, et de le faire fabriquer par nos étudiants pour faire ce saut technologique et dire d'une manière non inhibée que Djibouti est capable de fabriquer un satellite, de le lancer, de collecter des résultats. Il en résulte que 10 techniciens et ingénieurs ont été formés », a déclaré Nabil Mohamed Ahmed, le ministre djiboutien de l’Enseignement supérieur et de la Recherche.
Le nouveau satellite est le fruit de la collaboration entre le gouvernement djiboutien et le Centre Spatial Universitaire de Montpellier (CSUM) en France. L’établissement a formé, dès 2020, les ingénieurs djiboutiens qui ont conçu, construit et testé le nanosatellite. En mars dernier, Djibouti 1A a passé avec succès les tests de vibration et en juillet, il a été déclaré prêt pour le lancement.
Djibouti 1A sera utilisé à des fins de recherche spatiale et de communication. Il recueillera les données nationales en temps réel des stations climatologiques et sismiques, notamment la température, la pluviométrie, la profondeur des cours d'eau et l'hydrométrie, afin d'aider à stimuler la production agricole et à surveiller les changements environnementaux.
Samira Njoya
Lire aussi :
L’île Maurice s’associe à l’Inde pour le développement conjoint d'un satellite
Avec l’arrivée de la technologie, il est devenu indispensable pour les étudiants de côtoyer l’outil informatique. En milieu carcéral, des innovations sont en cours dans ce sens en Afrique du Sud.
La Cour suprême d’appel (SCA) sud-africaine a donné 12 mois au gouvernement pour préparer et promulguer une politique révisée pour les centres correctionnels afin de permettre aux détenus d'utiliser des ordinateurs personnels dans leurs cellules à des fins d'étude.
Désormais, un détenu inscrit dans un établissement d'enseignement supérieur reconnu et qui a besoin d'un ordinateur pour ses études, aura le droit d'en utiliser un sans Internet dans sa cellule.
« Je constate que de plus en plus de matériel pédagogique est disponible sous forme électronique et que l'accès à ce matériel se fait de la manière la plus pratique et la plus économique à partir d'un ordinateur », a déclaré le juge David Unterhalter.
« Les travaux de cours sont désormais couramment composés et soumis par voie électronique. J'ai constaté que le droit à la poursuite de l'éducation inclut le droit de poursuivre effectivement cette éducation. Si un détenu dispose d'un ordinateur personnel, il s'agit d'un outil d'une valeur indispensable pour suivre de nombreux cours de formation continue », a-t-il ajouté.
La décision de réviser cette politique intervient après qu'un détenu de Johannesburg, qui purgeait une peine de 20 ans pour vol qualifié, s'était plaint d'avoir du mal à terminer son cours d'informatique parce qu'il ne pouvait pas travailler depuis sa cellule où il passait la majeure partie de son temps. En attendant l'examen de la politique, le juge a déclaré que détenu a le droit d'utiliser son PC dans sa cellule tant qu’il reste inscrit dans un établissement d'enseignement supérieur ou universitaire reconnu en Afrique du Sud.
Toutefois, le détenu doit mettre l'ordinateur à disposition pour inspection à tout moment et toute violation des règles par un détenu individuel pourrait entraîner le retrait de l'ordinateur.
Samira Njoya
Lire aussi :
Kenya : 67 cours de justice bientôt connectées au réseau national de fibre optique
Le Tchad a lancé en 2020 un nouveau plan stratégique de développement du numérique et des Postes, témoignant de la volonté du gouvernement de rattraper le retard technologique. Pour la mise en œuvre des projets dudit plan, le pays a besoin de partenaires expérimentés.
L’Egypte et le Tchad souhaitent collaborer dans le domaine de l’économie numérique. La question a fait l’objet de discussions entre Mahamat Allahou Taher (photo, au centre), le ministre tchadien des Télécommunications et de l’Economie numérique, et une délégation égyptienne en marge d’une réunion de travail tenue le jeudi 9 novembre à N’Djamena au Tchad.
Selon le ministère tchadien chargé de l’Economie numérique, les discussions ont porté, entre autres, sur la question de l’interconnexion en fibre optique internationale (Tchad-Egypte), la numérisation de l’administration publique tchadienne et la formation des cadres en compétences numériques.
La rencontre s’inscrit dans le cadre du plan stratégique de développement du numérique et des postes (PSDNP 20-30) lancé par le gouvernement du Tchad en 2020. Elle intervient dans un contexte marqué par l’accélération de la transformation numérique dans le pays et la relance des travaux de la dorsale transsaharienne à fibre optique au Tchad.
Pour l’Egypte, la réunion cadre avec les actions engagées par le gouvernement pour réaliser sa stratégie de transformation numérique dénommée « Digital Egypt 2030 ». Pour y parvenir, Le Caire multiplie les partenariats avec des pays avec lesquels il entretient de bonnes relations.
La collaboration entre les deux pays devrait permettre au Tchad de profiter pleinement de l’Egypte qui est déjà très avancée dans sa transformation numérique, notamment dans l’e-gouvernance et dans la fourniture de la connectivité à haut débit. Le pays prévoit de délivrer des licences de réseau 5G aux opérateurs télécoms d’ici décembre. Pour ce qui est de la fourniture des services en ligne, le pays a lancé depuis 2019 la dématérialisation de la plupart de ses services publics. L’initiative lui a valu en 2022, le 6e rang sur 16 pays africains champions de l’administration électronique en Afrique selon les Nations unies.
Samira Njoya
Lire aussi :
Le Nigeria fait partie des pays africains disposant des écosystèmes technologiques les mieux avancés. Pourtant, les autorités multiplient les actions pour améliorer cet écosystème.
Bosun Tijani (photo), ministre nigérian des Communications, de l’Innovation et de l’Economie numérique, a révélé le mardi 7 novembre lors de la réunion du Conseil national nigérian des responsables des TIC des ministères, départements techniques et agences du pays l’obtention d’un montant de 1 milliard de nairas (environ 1,2 million $) pour le programme Trois millions de talents techniques. Les fonds, provenant d’une entreprise privée, contribueront à la mise en place d'un réseau de talents techniques au Nigeria afin de renforcer l'économie numérique.
« Lorsque j'ai pris mes fonctions et que j'ai dit que le ministère allait former 3 millions de personnes, nous n'avions pas les ressources nécessaires, mais chaque jour, des entreprises et des organisations viennent soutenir l'initiative.Le ministère n'avait pas de budget pour exécuter le projet, mais aujourd'hui, une entreprise va nous donner 1 milliard de nairas pour ce projet », a indiqué Bosun Tijani.
I take my role as chairman of the Nigeria National Council of ICT Heads in MDAs as a significant opportunity to work with ICT heads across government to inject innovation into public service. Speaking yesterday at the meeting of the council in Abuja, I stressed the importance of… pic.twitter.com/Hk9XAmhKiv
— Dr. 'Bosun Tijani (@bosuntijani) November 8, 2023
Depuis sa nomination en août dernier, le ministre nigérian a mené diverses actions pour dynamiser le secteur technologique de son pays avec l’aide du gouvernement et de différents partenaires techniques et financiers. D’ailleurs, le pays a mobilisé 500 millions $ dès la prise de fonction de Bosun Tijani dans le but de soutenir l’innovation et l’entrepreneuriat dans le secteur du numérique. En septembre dernier, il a signé un partenariat avec Central Square Foundation, une organisation non gouvernementale indienne, dans le but de mettre sur pied des solutions pour faciliter l’enseignement et l'apprentissage au Nigeria à travers les nouvelles technologies.
Toutefois, Bosun Tijani n’est pas satisfait des réalisations des autorités locales. Il s’est montré quelque peu acerbe en soulignant lors de la réunion que « le gouvernement nigérian devrait disposer d'un institut de recherche technologique digne de ce nom, mais il incombe à ce conseil de veiller à ce que le projet d'économie numérique de cette administration soit effectivement mis en œuvre ».
Adoni Conrad Quenum
Lire aussi :
L’Afrique reste la région du monde où les enjeux de santé sont les plus importants et critiques. Une bonne utilisation du numérique dans ce domaine pourrait constituer une chance pour le développement des systèmes de santé sur le continent.
Les Seychelles veulent accélérer la numérisation de leurs services de santé. Le pays a décidé d'évaluer la maturité de son système de santé numérique par un outil développé en partenariat par le Secrétariat du Commonwealth, le Commonwealth Centre for Digital Health (CWCDH), et l'Organisation mondiale de la santé (OMS).
L’information a été révélée lors d'un récent atelier de quatre jours tenu à Mahé en présence des responsables de la santé du pays, des représentants du Commonwealth et des partenaires internationaux.
#Seychelles has joined the list of countries seeking to assess their 'digital health readiness' using a tool developed in partnership between the #Commonwealth Secretariat, @CWCDH_info and @WHO.
— The Commonwealth (@commonwealthsec) November 7, 2023
Read more 👇 #CommonwealthHealth
S’exprimant sur le sujet, la ministre de la Santé des Seychelles, Peggy Vidot, a fait savoir que l’outil permet de mesurer les progrès de la transformation numérique du secteur. « En cette ère marquée par des progrès technologiques rapides, l'intégration de solutions de santé numérique apparaît comme un impératif critique. Les Seychelles s'engagent dans un voyage de transformation, en tirant parti de la puissance de l'innovation numérique pour renforcer notre système de santé ».
Les premières conclusions de l'évaluation, ont déterminé entre autres que le gouvernement des Seychelles a réalisé des progrès significatifs dans ses efforts visant à renforcer les systèmes de santé numériques, notamment en investissant dans un système d'information sur la santé électronique.
Les résultats ont également souligné qu’il reste beaucoup à faire, notamment mettre en place des systèmes de feedback des utilisateurs et des patients dans les solutions numériques, adopter des normes pour l’infrastructure réseau et la formation, veiller à ce que le suivi et l’évaluation fassent partie de la mise en œuvre des projets, cartographier les solutions, politiques et lignes directrices numériques existantes dans une stratégie de santé numérique, mettre en place une législation en matière de stockage et de sécurité des données.
Samira Njoya
Lire aussi :
Après de nombreuses années d’instabilité politique, la Somalie fait de plus en plus parler d’elle pour les actions des autorités visant à développer le pays. Elles sont particulièrement concrètes dans le secteur technologique.
Le ministère somalien des Communications et de la Technologie a annoncé le mardi 7 novembre la signature d’un mémorandum d’entente avec l’Union internationale des télécommunications lors de l’édition 2023 du Forum régional de développement de l’UIT pour les Etats arabes à Manama au Bahreïn. L’objectif est de faire progresser le développement numérique, les politiques en matière de TIC, la cybersécurité, le renforcement des capacités, le renforcement de l'infrastructure numérique et la connectivité dans le pays.
« Le gouvernement de Somalie renforce la coopération de l'UIT, cet accord est utilisé pour promouvoir le processus de modernisation et de changement en Somalie, qui vise à construire et développer le changement qui conduit au développement durable de la technologie et du numérique », a indiqué Jama Hassan Khalif, ministre somalien des Communications et de la Technologie.
.@MoCTSomalia has signed a significant Framework Cooperation Agreement with the International Telecommunication Union @ITU. This historic cooporation aims to advance digital development, ICT policies,cybersecurity,capacity building, strengthening digital infrastructure, and….. pic.twitter.com/GjNI5GBFxb
— Ministry of Communications & Technology (MoCT) (@MoCTSomalia) November 7, 2023
Malgré un contexte politico-sécuritaire difficile, la Somalie fait le nécessaire pour s’accrocher au train de la révolution numérique en cours sur le continent. Le pays multiplie les actions depuis quelques années, conformément à sa Politique et Stratégie TIC 2019-2024, et divers partenaires techniques et financiers accourent pour soutenir les efforts des autorités locales.
En octobre 2022, l'Union européenne, Expertise France (EF), l’Agence de coopération internationale allemande pour le développement (GIZ) et l’International and Ibero-American Foundation for Administration and Public Policies (FIIAPP) ont lancé le programme « Digital for Development – D4D » d’un budget de 11 millions d’euros pour soutenir la transformation numérique de plusieurs pays de la Corne de l’Afrique, dont la Somalie. En septembre dernier, elle a lancé une consultation pour le futur déploiement de l’Internet de cinquième génération dans le pays et a lancé son système d'identification national.
Avec moins de 2 millions d’utilisateurs d’Internet et un taux de pénétration de 9,8%, ce nouvel accord devrait permettre, entre autres, de réduire la fracture numérique et de favoriser le progrès technologique du pays. Notons que le pays fait toujours partie des mauvais élèves du continent en matière d’e-gouvernement, selon l’édition 2022 du rapport « E-Government Survey 2022 The Future of Digital Government » du département des questions économiques et sociales des Nations unies (UN DESA).
Adoni Conrad Quenum
Lire aussi :
La République fédérale de Somalie a lancé son système d'identification national
L'Union européenne soutient le gouvernement numérique dans la Corne de l'Afrique
More...
Lors du sommet Etats-Unis - Afrique en décembre 2022, Cisco Systems avait annoncé une contribution en nature de 200 millions de dollars en Afrique. Un an après cette annonce, les retombées sont déjà visibles.
La multinationale technologique Cisco a récemment inauguré un sixième centre d’incubation de petites et moyennes entreprises (PME) en Afrique du Sud, en partenariat avec Mafikeng Digital Innovation Hub (MDIHub), un centre techno innovant de coworking basé à Mahikeng.
Le nouveau hub baptisé EDGE Centre pour Experience, Design, GTM (Go to Market), and Earn a pour objectif de soutenir le développement des PME à l'ère numérique, en les aidant à accéder aux technologies de pointe en matière de connectivité et de mise en réseau.
We are launching on friday pic.twitter.com/oHMrg71heE
— MDiHub (@MafIHub) November 1, 2023
« Il est essentiel d'apporter l'expérience Cisco EDGE aux régions, y compris le Nord-Ouest, pour donner aux Sud-Africains une chance de participer à l'économie numérique mondiale. Chez Cisco, nous pensons que la technologie joue un rôle essentiel dans la construction d'un avenir inclusif pour tous. En connectant les personnes et les entreprises via l'écosystème et les plateformes Cisco, nous créons un impact réel et aidons à préparer le pays à un avenir numérique », a expliqué Clayton Naidoo, directeur principal de l'accélération numérique au niveau national chez Cisco Afrique.
Le nouveau centre lancé par Cisco s’inscrit dans le cadre de son programme nommé Country Digital Acceleration (CDA), introduit en Afrique du Sud en 2019. Le programme mondial a pour but de mettre en place des centres EDGE ayant pour objectif de contribuer à la transformation numérique sécurisée des gouvernements et des entreprises.
Le centre servira d'espace de partage de connaissances commerciales pour stimuler l'innovation des entreprises. Il proposera également une formation aux compétences numériques par l'intermédiaire de la Cisco Networking Academy, un programme de formation à l'informatique et à la cybersécurité qui s'associe à des établissements d'enseignement dans le monde entier.
Soulignons qu’en Afrique du Sud, Cisco a déjà formé près de 260 000 apprenants dans le cadre de ce programme, avec un fort taux de participation féminine de 50 %.
Samira Njoya
Lire aussi :
Depuis quelques années, la plupart des pays africains sont en transition numérique. Ils prennent des décisions stratégiques et lancent des outils numériques à cette fin.
Bola Tinubu (photo), le président de la République fédérale du Nigeria, a lancé le lundi 6 novembre à Abuja le système électronique d’enregistrement des faits d’état civil et de statistiques vitales (e-CRVS). C’est le fruit de la collaboration entre de la Commission nationale de la population (NPC), l’Organisation des Nations unies pour l’enfance (UNICEF) et Barnksforte Technologies Limited, une entreprise spécialisée dans la fourniture de solutions technologiques en Afrique et dans le monde.
PRESS RELEASE
— National Population Commission (@natpopcom) November 6, 2023
Launching of the National Geospatial Data Repository, the Digital Civil Registration & Vital Statistics System and the Inauguration of the National CRVS Coordination Committee pic.twitter.com/tCBZtgPgUx
Ce nouvel outil technologique devrait contribuer à l’atteinte de l'objectif de développement durable (ODD) 16.9.2 relatif à l'identité légale pour tous. Outre l’e-CRVS, le Référentiel national de données géospatiales et le Comité national de coordination sur le système d'enregistrement des faits d'état civil ont été également lancés lors du même événement.
« La numérisation de l'état civil au Nigeria va au-delà de la technologie ; c'est un engagement envers les générations futures. Maintenant l'existence de chaque enfant sera reconnue, marquant une nouvelle ère où chaque événement important de la vie informe le développement de notre Nation », a indiqué Cristian Munduate, représentante de l'UNICEF au Nigeria.
En octobre 2022, les ministres africains chargés de l’état civil se sont réunis à Addis-Abeba pour réfléchir aux progrès et accélérer les efforts vers 2030 grâce à des systèmes réformés. La conférence visait à fournir une plateforme dynamique pour l’éducation, la sensibilisation, le partage de connaissances et d’expériences sur le CRVS, les processus et produits d’identité juridique. C’est dans ce cadre que les autorités nigérianes ont pris les devants pour la mise en place de leur e-CRVS, ce qui permettra entre autres de recueillir des informations telles que l'enregistrement des naissances, l'enregistrement des enfants mort-nés, l'attestation de naissance, l'adoption, la notification de mariage, la notification de divorce, la migration ou encore les actes de décès.
Speech: Press Briefing on the Presidential Launch of the Electronic Civil Registration and Vital Statistics System and National Geospatial Data Repository delivered by the NPC Chairman, Hon. Nasir Isa Kwarra, fnsa at the NPC's Headquarters, Abuja today, 6th November 2023. pic.twitter.com/wSssvUzGeA
— National Population Commission (@natpopcom) November 6, 2023
« Il s'agit d'accélérer l'amélioration des systèmes d'enregistrement de l'état civil et de statistiques vitales au Nigeria sur une période de dix ans, de 2023 à 2030, afin d'atteindre l'objectif de développement durable 16.9.2 — l'identité légale pour tous, y compris l'enregistrement des naissances », explique Nasir Isa Kwarra, président de la Commission nationale de la population.
Adoni Conrad Quenum
Lire aussi :
Le Nigeria, le Kenya et le Rwanda signent une déclaration mondiale sur les risques liées à l’IA
Alors que la transformation numérique s’accélère en Afrique, il devient plus qu’important de former tous les acteurs aux compétences nécessaires pour cette mutation. Des partenariats se multiplient dans ce sens dans le continent.
Le ministère zimbabwéen chargé des TIC, des Services postaux et des Services de messagerie a signé un protocole d'accord avec la Computer Society of Zimbabwe (CSZ), un organisme professionnel regroupant des professionnels des TIC.
L’accord signé en marge du sommet annuel CSZ 2023, qui s’est tenu du mercredi 1er au dimanche 5 novembre, vise à s’assurer que tous les fonctionnaires obtiennent la certification internationale d’informatique ICDL.
« L'objectif du protocole d'accord est de faire en sorte que les fonctionnaires maîtrisent le numérique, ce qui permettra à l'avenir de disposer d'une population numérique. Ce protocole d'accord garantit des améliorations. Il garantit l'amélioration de la culture numérique dans le secteur public, ce qui se traduira par une nation numériquement qualifiée à l'avenir », a déclaré Viola Dondo, la directrice exécutive de CSZ.
Dans le cadre de l’accord, la CSZ aidera le ministère des TIC à veiller à ce que la certification ICDL soit mise en œuvre. L’objectif est de faire en sorte que tous les fonctionnaires soient certifiés dans les modules ICDL recommandés par la CSZ.
Le certificat comporte une série de programmes qui répondent aux exigences du monde numérique d'aujourd'hui. Le module ICDL Workforce par exemple permettra aux fonctionnaires d'atteindre la norme numérique requise sur leur lieu de travail.
Cette nouvelle initiative s’inscrit dans le cadre des ambitions de transformation numérique du gouvernement zimbabwéen. L’objectif est de faire participer tous les acteurs à la numérisation en cours dans le pays.
« Mon ministère s'attend à ce que la CSZ continue à participer au projet "Smart Zimbabwe 2030", qui met l'accent sur le partage des infrastructures, le renforcement des compétences et des capacités, les politiques et les réglementations », a déclaré Tatenda Matevera (photo), ministre des TIC.
Samira Njoya
Lire aussi :
Les fournisseurs de centres de données multiplient les investissements sur le marché africain. Un acteur local essaye de renforcer sa présence sur le continent en annonçant une expansion.
MainOne, un fournisseur nigérian de centres de données, a annoncé le lundi 6 novembre la mise en service d’un nouveau centre de données au Village des Technologies de l’Information et de la Biotechnologie (VITIB) situé dans la ville de Grand-Bassam en Côte d’Ivoire. L’objectif est, entre autres, de répondre aux demandes croissantes de services numériques, de connectivité et de stockage de données en Côte d'Ivoire et en Afrique de l'Ouest francophone.
We are excited to announce the launch of our expanded open access, carrier-neutral, Uptime Tier III standards Data Center, AB1.2, in VITIB, Grand Bassam, Cote d’Ivoire, in November 2023.
— MainOne (an Equinix Company) (@Mainoneservice) November 6, 2023
Read more here : https://t.co/22YxssfikI#MainOne #infastructure #MDXiDataCenter pic.twitter.com/1ZNe6zPiCX
« Avec le lancement de notre nouveau datacenter en Côte d'Ivoire, nous entrons dans une phase passionnante de transformation digitale pour les entreprises, car il offre une excellente opportunité pour accueillir plus de clients dans notre riche écosystème numérique qui est interconnecté aux principaux acteurs du digital de la région offrant une connectivité à Internet 100 % disponible », a déclaré Etienne Kouadio Doh, directeur général de la filiale ivoirienne de MainOne.
Comme de nombreux fournisseurs de services cloud, MainOne surfe sur le caractère prometteur du marché africain. Le fournisseur nigérian, qui a implanté son premier centre de données sur le continent en 2019, veut soutenir son expansion et le choix de la nation éburnéenne n’est pas anodine, puisque c’est le terrain de jeu favori de nombreuses compagnies de renommée mondiale en Afrique occidentale. Le groupe français Orange et l’américain Oracle ont signé en octobre 2021 un partenariat pour la construction de plusieurs régions cloud africaines incluant la Côte d'Ivoire. En novembre 2022, le fournisseur de centres de données neutres Raxio Group a annoncé la construction de sa première infrastructure à Grand-Bassam. Il a pour but d’en construire plus d’une dizaine avant 2025 sur le continent.
« Nous nous attendons à ce que ces infrastructures numériques de pointe deviennent un catalyseur de l'innovation digitale, en fournissant une plateforme robuste permettant aux entreprises de prospérer tout en renforçant davantage la position de la Côte d'Ivoire comme plaque tournante du numérique de l'Afrique de l'Ouest francophone », a indiqué Etienne Kouadio Doh.
Pour rappel, MainOne est une filiale d’Equinix, un fournisseur mondial d'infrastructures numériques qui dispose de plus de 240 centres de données dans le monde dans 32 pays, sur cinq continents.
Adoni Conrad Quenum
Lire aussi :
Raxio investit dans un centre de données en Côte d'Ivoire
Raxio Data Centres lève 46 millions $ pour se développer en Afrique
Cloud computing : les opportunités et défis en Afrique selon Orange CI