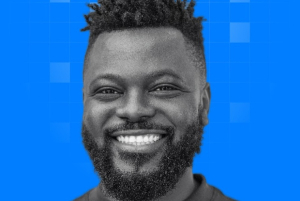Nigeria : Timon simplifie les paiements pour voyageurs et nomades numériques
Dans un monde de plus en plus connecté où les frontières s’effacent au profit des expériences internationales, Timon se positionne comme une solution financière tout-en-un pour voyager, payer et gérer son argent sans friction.
Timon est une solution numérique développée par une jeune pousse nigériane. Elle est conçue pour les voyageurs fréquents, les étudiants internationaux, les travailleurs à distance et tous ceux qui mènent une vie « borderless ». La start-up a été lancée en 2023 par Oluwatomi Olarinde (photo) et Chizaram Ucheaga.
Au cœur de l’offre de Timon se trouve une application mobile qui regroupe plusieurs fonctionnalités telles que la création et la gestion de portefeuilles multi-devises (naira, dollar, etc.), des cartes de paiement physiques et virtuelles acceptées dans plus de 100 pays, ainsi que des services complémentaires comme les eSIM internationales et les transferts d’argent. L’application est accessible sur iOS et sur android où elle a déjà été téléchargée plus de 50 000 fois, selon les statistiques de Play Store.
« Nous respectons les réglementations financières locales et internationales, utilisons des systèmes avancés de prévention de la fraude et avons recours à un cryptage conforme aux normes de l'industrie, afin de protéger vos fonds et vos renseignements personnels en tout temps », indique la jeune pousse.
Les utilisateurs peuvent, depuis la plateforme mobile, payer en ligne ou en magasin, planifier leurs voyages, activer des cartes instantanément et même convertir des stablecoins en devises dépensables. Timon promet une expérience fluide, avec des frais transparents, des déploiements rapides et une interface pensée pour le mode de vie global des utilisateurs africains et de la diaspora.
En combinant gestion financière, connectivité mondiale et cartes universelles, cette fintech nigériane se présente comme un « passeport financier numérique » pour les aventuriers du 21ᵉ siècle, nomades numériques ou professionnels en mobilité.
Adoni Conrad Quenum
Lire aussi:
Tunisie : Skirora démocratise l’apprentissage en ligne via ses plateformes web et mobile
Paycrest : Chibuotu Amadi relie les cryptomonnaies aux devises du quotidien
Il imagine une nouvelle manière de faire circuler l’argent entre monnaies locales et numériques. Une vision qui redéfinit les usages de la cryptomonnaie dans la vie quotidienne.
Chibuotu Amadi (photo) est un entrepreneur et ingénieur logiciel nigérian. Il est cofondateur et directeur général de Paycrest, une infrastructure de paiement qui vise à rendre les transactions en cryptomonnaies aussi simples et accessibles que les paiements traditionnels, partout dans le monde, aussi bien pour les particuliers que pour les entreprises.
Fondée en 2024, Paycrest a pour mission de démocratiser l’accès financier à travers des paiements fluides entre monnaies numériques et devises locales. L’entreprise ambitionne de réduire les frais, de simplifier les démarches et d’éliminer les frictions associées à l’utilisation quotidienne des cryptomonnaies.
Paycrest propose des outils ouverts qui permettent de régler ou de recevoir des paiements en crypto, tout en envoyant ou recevant de la monnaie locale sur des comptes et portefeuilles classiques. En coulisses, le système s’appuie sur un réseau de fournisseurs de liquidité pour transformer instantanément la valeur entre cryptomonnaies et monnaies traditionnelles, avec des coûts réduits. Ces outils sont pensés pour être utilisés par des particuliers, des commerçants en ligne, des entreprises ou des projets de finance décentralisée.
Entrepreneur en série, Chibuotu Amadi crée sa première entreprise en 2014 : SMSLeak, spécialiste des services SMS en masse au Nigeria. L’entreprise fournit des solutions d’envoi de messages à grande échelle pour la publicité, la promotion de ventes, les lancements de produits et la relation client.
En 2018, il cofonde Cura Network, où il occupe le poste de directeur technique jusqu’en 2022. Cette entreprise développe un système de santé mondial décentralisé réunissant diverses entités qui collaborent et partagent des données afin de promouvoir, restaurer et maintenir la santé.
Chibuotu Amadi est diplômé de l’University of Benin (Nigeria), où il a obtenu en 2016 un Bachelor en ingénierie informatique. En 2015, il effectue un stage d’ingénieur logiciel au Manipal Institute of Technology, en Inde.
En 2019, il rejoint Inkredo, une société financière indienne, en tant que développeur full stack. Parallèlement, il travaille chez Smarter.Codes, une entreprise spécialisée dans le développement logiciel. L’année suivante, il intègre ConsenSys, une société américaine proposant une suite de produits destinés à concevoir diverses solutions dans l’univers du Web3. De 2021 à 2023, il occupe le même poste chez Gitcoin, une organisation américaine engagée dans le financement de projets communautaires.
Melchior Koba
Lire aussi:
ZLECAf : Onafriq et PAPSS simplifient les paiements entre le Nigeria et le Ghana
Cameroun : Signe Fokui Maxime veut simplifier les échanges d’argent en ligne
Son objectif est de rendre les transactions financières plus simples et accessibles. Son approche allie innovation, inclusion financière et vision panafricaine du numérique.
Signe Fokui Maxime (photo) est un développeur de logiciels et un entrepreneur technologique originaire du Cameroun. Il est le fondateur et directeur général de Bitkap, une application multifonction qui fait office de porte-monnaie numérique, solution d’envoi d’argent et moyen de paiement en ligne.
Lancée en 2020, Bitkap permet à ses utilisateurs de déposer, conserver, envoyer et retirer de l’argent en francs CFA et en dollars. Conçue pour simplifier les transactions quotidiennes, l’application offre une expérience fluide et rapide, réalisable en quelques clics seulement.
Les utilisateurs peuvent alimenter leur compte en FCFA ou en USD, puis effectuer des transferts via un nom d’utilisateur appelé cashTag ou un code QR, sans divulguer leurs coordonnées bancaires ni leur numéro de mobile money. Les transferts internationaux sont gratuits, évitant ainsi les frais élevés souvent associés aux envois d’argent à l’étranger.
Bitkap se distingue également par sa fonction de conversion instantanée : il est possible de déposer dans une devise et de retirer dans une autre, sans passer par un service de change traditionnel et ses taux souvent élevés. L’application affiche en temps réel les variations des taux entre le franc CFA (XAF) et le dollar (USD), aidant ainsi l’utilisateur à choisir le moment le plus favorable pour convertir ses fonds. L’envoi d’argent à un proche s’effectue en quatre étapes simples, avec un suivi continu depuis la plateforme.
En outre, Bitkap permet de générer des cartes Visa virtuelles instantanées pour des paiements en ligne sur des plateformes telles que Facebook, Amazon, Netflix, PayPal ou encore des sites de paris. Les utilisateurs peuvent également acheter immédiatement du crédit téléphonique, en FCFA ou en dollars, pour tous les opérateurs mobiles disponibles au Cameroun.
Signe Fokui Maxime est titulaire d’un diplôme d’études universitaires générales (DEUG) en mathématiques obtenu en 2016 à l’université de Douala, ainsi que d’une licence en génie logiciel décrochée en 2019 à l’université de Dschang. Il a ensuite poursuivi ses études à l’École supérieure des technologies de l’information appliquées aux métiers (ESTIAM), en France, où il a obtenu en 2024 un master en intelligence artificielle.
Sa carrière professionnelle commence en 2016 chez Ring Corporation, une fintech camerounaise, en tant que développeur. En 2019, il rejoint ACESY, une entreprise informatique, comme ingénieur principal en développement logiciel, avant d’intégrer quelques mois plus tard Dembou Consulting, une société technologique française, où il occupe le poste de développeur Java jusqu’en 2020.
Melchior Koba
Lire aussi:
GoCab lève 45 millions de dollars pour étendre la mobilité électrique et inclusive en Afrique
Présentée comme une solution au déficit de financement des travailleurs de l’économie des plateformes en Afrique, GoCab cherche à accélérer son passage à l’échelle. La fintech s’appuie sur cette nouvelle levée de fonds pour renforcer son modèle de mobilité inclusive et électrique.
Dans un communiqué publié le mardi 3 février, la fintech GoCab, spécialisée dans la mobilité et le financement de véhicules, a annoncé la clôture d’un tour de table de 45 millions de dollars. L’opération comprend 15 millions de dollars en fonds propres et 30 millions de dollars en dette, et vise à accélérer le déploiement de solutions de mobilité électrique et inclusive sur plusieurs marchés africains.
Menée par E3 Capital et Janngo Capital, la levée de fonds a également réuni KawiSafi Ventures et Cur8 Capital. Selon l’entreprise, les ressources mobilisées serviront à renforcer ses activités sur ses marchés actuels, à s’implanter dans de nouvelles villes à forte croissance et à augmenter la part de véhicules électriques au sein de sa flotte. GoCab prévoit par ailleurs de déployer des outils basés sur l’intelligence artificielle pour le scoring, l’optimisation de flotte et la gestion des risques.
« En Afrique, des millions de personnes restent exclues à la fois de la mobilité et du financement. Ce tour de table nous permet de changer d’échelle tout en élargissant l’accès à un financement éthique et en accélérant la transition vers la mobilité électrique », souligne Azamat Sultan, cofondateur et président exécutif de GoCab.
Fondée en 2024 par Azamat Sultan et Hendrick Ketchemen, deux anciens professionnels de la banque d’investissement spécialisés en finance structurée et en marchés émergents, GoCab s’est donné pour objectif de répondre à l’accès limité au financement et à la propriété de véhicules pour les travailleurs de l’économie des plateformes. L’entreprise propose un modèle permettant aux chauffeurs et livreurs de générer des revenus réguliers tout en accédant progressivement à la propriété de leur véhicule.
Après 18 mois d’activité, GoCab est présente sur cinq marchés africains et revendique plus de 17 millions de dollars de revenus annuels récurrents. L’entreprise emploie aujourd’hui plus de 120 personnes issues de 18 nationalités. Elle accompagne plusieurs milliers de chauffeurs et entend contribuer à la structuration de systèmes de mobilité urbaine plus durables.
Dans un contexte où l’Afrique compte une population croissante de travailleurs de l’économie des plateformes, encore largement exclue des systèmes financiers traditionnels, GoCab ambitionne de s’imposer comme un acteur clé de la mobilité durable. À moyen terme, l’entreprise vise le déploiement de 10 000 véhicules opérationnels et l’atteinte de 100 millions de dollars de revenus annuels récurrents, en s’appuyant sur un modèle combinant financement éthique, technologie et transition énergétique.
Samira Njoya
Lire aussi:
EV24.africa et ZEMIA s’unissent pour accélérer la mobilité électrique en Zambie
Uber quitte la Tanzanie, fragilisée par les règles tarifaires imposées par l’État
Suleiman Murunga simplifie les paiements transfrontaliers pour entreprises et particuliers
Il s’attaque à un point de friction central des échanges financiers mondiaux. À travers sa solution, il vise à fluidifier les échanges entre acteurs économiques, au‑delà des frontières.
Suleiman Murunga (photo) est un entrepreneur ougandais spécialisé dans la finance numérique. Il est le fondateur et directeur général de Muda, une plateforme conçue pour faciliter les paiements internationaux.
Fondée en 2021, Muda permet d’envoyer et de recevoir des paiements à l’échelle mondiale via une interface unique. La société prend en charge la conformité réglementaire, la conversion des devises et la livraison des fonds jusqu’au bénéficiaire final. Elle offre un accès à l’argent dans plus de 50 pays, aussi bien en monnaies fiduciaires qu’en formes numériques, pour les particuliers comme pour les entreprises.
Muda se positionne comme une plateforme complète répondant à la fois aux besoins des entreprises (paiements fournisseurs, opérations transfrontalières, etc.) et à ceux des particuliers, notamment pour les transferts rapides et les services de type remittance. L’objectif est d’assurer une expérience fluide pour tous les usagers, grâce à une base technologique commune et des services harmonisés.
Les entreprises peuvent obtenir des numéros de comptes dédiés (IBAN ou comptes locaux) par client ou par corridor de paiement, facilitant ainsi le suivi et la réconciliation des flux financiers. Muda propose également des portefeuilles pour différentes formes d’actifs numériques (USDC, USDT, cNGN, entre autres), assortis de règles internes, de traces d’audit et d’une compatibilité multi‑réseaux.
En parallèle, Suleiman Murunga est le directeur de Murcom, une société de développement de logiciels qui pilote plusieurs initiatives liées à la blockchain. Il siège également au conseil d’administration de la Blockchain Association of Uganda, qui rassemble des professionnels, experts et passionnés du secteur. Sa première entreprise, M‑Duka, est une fintech qu’il a fondée en 2012 et dirigée jusqu’en 2015.
Il est diplômé de la Coventry University en Angleterre, où il a obtenu en 2010 un bachelor en gestion du marketing. En 2015, il rejoint la fintech Pegasus Technologies en tant que directeur général. De 2017 à 2021, il était le directeur de Coinpesa, une bourse d’actifs numériques visant à démocratiser les cryptomonnaies.
Melchior Koba
Edité par Sèna D. B. de Sodji
Lire aussi:
L’Ougandais Ntende Isabirye élargit l’accès aux compétences numériques en milieu rural ...
Bénin : Sabi Yarou Sika OROU N’GOBI facilite l’achat et la vente de cryptomonnaies
En misant sur l’échange direct entre utilisateurs, il répond à un besoin concret souvent ignoré des solutions financières classiques. Il redéfinit le rapport des utilisateurs à leur argent et aux cryptomonnaies.
Sabi Yarou Sika OROU N’GOBI (photo) est un expert en blockchain, développeur et entrepreneur technologique béninois. Il est le fondateur et directeur général de KryptaPay, une plateforme conçue pour permettre l’achat et la vente de cryptomonnaies de manière simple et sécurisée, grâce à des échanges directs entre utilisateurs.
Fondée en 2022, KryptaPay met l’accent sur la protection des fonds, la rapidité des transactions et la réduction des coûts. La plateforme permet d’acheter, vendre et échanger des cryptomonnaies via un modèle pair à pair. Les utilisateurs conservent ainsi le contrôle total de leurs fonds, choisissent librement leurs partenaires de transaction et fixent leurs propres prix sur le marché proposé. Les fonds sont collectés et distribués de manière quasi instantanée.
KryptaPay propose également des services de transfert d’argent international à faible coût, en particulier depuis la diaspora vers l’Afrique. La plateforme offre jusqu’à 000 transactions sans frais tant qu’aucun retrait n’est effectué. Les cryptomonnaies ne sont jamais conservées par KryptaPay : elles transitent directement d’un utilisateur à un autre, renforçant ainsi la sécurité et la transparence des échanges.
Les utilisateurs peuvent générer des revenus supplémentaires grâce à un système de parrainage actif lors des échanges. Ils disposent d’un tableau de bord personnel leur permettant de suivre leurs finances en temps réel. KryptaPay propose aussi un programme de vendeurs certifiés donnant accès à des avantages exclusifs, à un système d’évaluation basé sur les notes des utilisateurs et à une assistance réactive.
En parallèle de ses activités entrepreneuriales, Sabi Yarou Sika OROU N’GOBI intervient comme consultant, formateur et expert en blockchain, DeFi et Web3. Il est également Binance Angel, un rôle qui consiste à promouvoir Binance et ses produits sur le continent africain. Entre 2021 et 2022, il a exercé comme community manager freelance.
Il est titulaire d’un Bac+2 en transport et logistique obtenu en 2011 à l’Institut universitaire de technologie de Parakou, au Bénin. Il est diplômé de la plateforme d’enseignement en ligne Founderz, où il a obtenu en 2023 un master en blockchain et Web3. Il a également suivi une formation de développeur web à International Consulting Canada. Il poursuit actuellement un bachelor en gestion et développement commercial à la Burgundy School of Business, en France.
Melchior Koba
Edité par Sèna D. B. de Sodji
Lire aussi:
Edouard Kougblenou simplifie l’échange de cryptomonnaies via le mobile money
RenYou : Khouloud Abada facilite l’accès au suivi dermatologique
En créant RenYou, elle entend combler un angle mort du parcours de soin cutané. La solution technologique est pensée pour structurer le suivi de la santé de la peau.
Khouloud Abada (photo) est une entrepreneure tunisienne et ingénieure de formation, spécialisée en génie des procédés chimiques. Elle est la fondatrice et la directrice générale de RenYou, une application conçue pour accompagner les personnes souhaitant mieux prendre soin de leur peau, avec l’appui direct de médecins et de spécialistes dermatologiques.
Fondée en 2023, RenYou propose une nouvelle approche de la télémédecine appliquée à la santé de la peau. L’application vise à simplifier le parcours de soin tout en garantissant un suivi encadré par des professionnels de santé. L’objectif est d’offrir un accompagnement personnalisé, adapté aux besoins de chaque utilisateur, plutôt qu’une solution uniforme.
La plateforme, alimentée par l’intelligence artificielle, permet aux utilisateurs de mieux comprendre l’état de leur peau, de suivre son évolution dans le temps et de bénéficier de conseils structurés pour traiter leurs problèmes cutanés. Pensée pour être accessible, RenYou facilite l’accès à l’information et au suivi, afin que chacun puisse s’approprier ses soins de manière autonome et continue.
L’application adopte par ailleurs une approche globale. Elle ne considère pas la peau de manière isolée, mais prend aussi en compte des facteurs tels que l’alimentation et le mode de vie, qui influencent directement son état. Cette vision vise à rappeler que la santé de la peau reflète souvent l’hygiène de vie. Dans cette logique, RenYou développe également des contenus éducatifs destinés à informer et sensibiliser le public au‑delà de l’usage de l’application.
Khouloud Abada est diplômée de l’Institut préparatoire aux études d’ingénieur de Tunis, où elle obtient en 2016 un bachelor en sciences appliquées. Elle décroche ensuite un master en énergie à l’Université de Tunis en 2020, puis un master en génie mécanique en 2021 à la Frankfurt University of Applied Sciences, en Allemagne.
Elle commence sa carrière professionnelle en 2020 comme ingénieure en procédés chimiques chez Medis, une entreprise spécialisée dans l’octroi de licences de médicaments génériques à des groupes pharmaceutiques. De 2021 à 2023, elle travaille comme ingénieure mécanique chez Audi UK, au sein du groupe automobile britannique, avant de se consacrer pleinement à son projet entrepreneurial avec RenYou.
Melchior Koba
Bernice Houy, la comptable sud-africaine qui simplifie le métier par le numérique
Son innovation change la manière dont les comptables travaillent au quotidien. Grâce à elle, les professionnels peuvent se concentrer sur l’essentiel et gagner un temps précieux.
Bernice Houy (photo) est une comptable expérimentée et une entrepreneure technologique sud‑africaine. Elle est la fondatrice et directrice générale de Fintura, une plateforme en ligne pensée pour simplifier le travail des comptables, en particulier ceux qui exercent en Afrique du Sud.
Fondée en 2023, Fintura aide les cabinets comptables à alléger une charge administrative chronophage, qui les éloigne souvent du cœur de leur métier. Le principe est volontairement simple : plutôt que de multiplier les outils pour gérer les tâches quotidiennes, les échéances, la conformité ou la communication avec les clients, la plateforme centralise l’ensemble de ces fonctions en un seul espace.
Fintura propose plusieurs fonctionnalités conçues pour répondre aux besoins concrets des professionnels de la comptabilité. Elle automatise de nombreuses tâches répétitives, comme le suivi des dates limites ou la collecte d’informations clés. Elle permet également de regrouper toutes les données clients dans un espace unique et de suivre plus facilement les obligations légales et administratives. Les documents, rappels et échanges internes sont eux aussi réunis au sein d’une seule application.
La plateforme intègre par ailleurs un assistant virtuel intelligent, baptisé Hank. Celui‑ci répond aux questions, rappelle les échéances, retrouve des documents ou suggère des modèles. Son rôle est d’aider les comptables à gagner du temps et à limiter les oublis.
Avant de lancer Fintura, Bernice Houy a fondé en 2018 Xena Accounting, un cabinet spécialisé en comptabilité, affaires et fiscalité, qu’elle a dirigé comme directrice générale jusqu’en 2025. Elle est aujourd’hui mentor au sein du Founder Institute, un accélérateur de start‑up.
Elle est titulaire d’un bachelor en comptabilité financière obtenu en 2017 à l’Université d’Afrique du Sud. Elle a achevé sa formation en 2023 par un diplôme d’études supérieures en comptabilité obtenu à la Milpark School of Financial Services, une école de commerce sud‑africaine.
Bernice Houy commence sa carrière professionnelle en 2014 comme gestionnaire de compte chez Fenns Incorporated, un cabinet comptable. De 2020 à 2024, elle a siégé au comité des finances de Justice Desk Africa, une organisation de défense des droits humains. En parallèle, elle a exercé comme directrice financière chez Solutions For Africa, une structure qui développe des solutions destinées à renforcer les capacités des entreprises, des particuliers et des organisations en Afrique et au‑delà.
Melchior Koba
Lire aussi:
Joshua Raphael automatise la gestion des parkings à fort trafic avec Parket
Cameroun : Franklin Kamga facilite les paiements en ligne pour les entreprises
Simplifier les paiements numériques est devenu un enjeu majeur pour les commerces en Afrique. Cet entrepreneur camerounais propose une approche innovante qui répond à ce défi.
Franklin Kamga (photo) est un développeur informatique et un entrepreneur technologique camerounais. Il est cofondateur et directeur général de Notch Pay, une plateforme de paiement en ligne conçue pour simplifier les transactions financières en Afrique.
Fondée en 2019 par Franklin Kamga et B. Zile Tankeu, Notch Pay propose une solution intuitive et sécurisée qui centralise plusieurs moyens de paiement en un seul endroit, permettant aux entreprises de recevoir de l’argent en ligne sans complication. La plateforme facilite l’encaissement des ventes réalisées sur les sites web ou applications des commerces.
Les utilisateurs peuvent générer des liens de paiement à partager par e‑mail, SMS ou messagerie instantanée, permettant à leurs clients de régler rapidement leurs achats, sans système complexe. Notch Pay offre également une fonction de facturation, qui permet d’envoyer des factures et de suivre les paiements associés.
Connecté à son espace professionnel, l’utilisateur dispose d’un tableau de bord complet affichant l’historique des transactions, le suivi des paiements, la gestion des clients et de nombreux outils pour piloter son activité. La plateforme s’adapte à différents types d’utilisateurs : entrepreneurs, petites entreprises, associations ou grandes structures peuvent bénéficier de services adaptés à leurs besoins.
Franklin Kamga est titulaire d’un diplôme d’ingénieur logiciel obtenu en 2015 à l’Institut africain d’informatique (IAI Cameroun). Il débute sa carrière professionnelle en 2016 comme développeur web chez Dark Code, une agence créative. En 2020, il rejoint LGL Transport, une entreprise de transport, comme développeur full stack.
Melchior Koba
Lire aussi:
Cameroun : Aloys Koum facilite l’accès aux pharmacies et aux conseils médicaux
Radius : Sunday Paul Adah permet aux étudiants de payer leurs études à l’étranger
Il s’attaque à l’un des principaux freins à la mobilité étudiante : la complexité des paiements internationaux. À travers sa solution numérique, il ouvre l’accès aux études à l’étranger pour des milliers d’étudiants confrontés à des obstacles financiers et administratifs.
Sunday Paul Adah (photo), entrepreneur nigérian installé à Boise (États‑Unis), est cofondateur et directeur général de Radius, anciennement Pay4Me App, une plateforme de paiement pensée pour simplifier les démarches financières des étudiants internationaux qui doivent régler des frais auprès d’écoles, d’institutions ou d’organisations situées à l’étranger.
Fondée en 2022, Radius permet de payer les frais de scolarité, de visa, d’examens ou de logement, en évitant les contraintes liées aux virements internationaux. L’application mobile offre la possibilité d’effectuer des paiements le jour même et de suivre en temps réel l’évolution des transactions, ce qui apporte davantage de visibilité et de sérénité aux utilisateurs.
La plateforme intègre des outils de gestion des devises avec des taux de change compétitifs, un élément clé pour les paiements transfrontaliers. Radius met en avant une interface simple d’utilisation ainsi qu’un service d’assistance disponible 24h/24 et 7j/7, afin d’accompagner les étudiants à chaque étape de leurs démarches financières liées à leurs études.
En parallèle, Sunday Paul Adah est le fondateur d’Across The Horizon, un cabinet de conseil en études à l’étranger créé en 2015. Cette structure accompagne les étudiants africains et leurs familles dans la recherche de formations internationales accessibles financièrement. En 2020, il fonde également Scholarships Africa, une plateforme dédiée à la recherche et à la candidature à des bourses d’études pour les étudiants internationaux.
Il est diplômé de l’Université d’État de Boise, où il obtient en 2021 un bachelor en études multidisciplinaires. Il est également titulaire d’un master en administration publique, gouvernement et politique obtenu en 2023 à l’Université Grand Canyon, ainsi que d’un master en création d’entreprise décroché en 2025 à la David Eccles School of Business de l’Université de l’Utah.
Melchior Koba
Edité par Sèna D. B. de Sodji
Lire aussi:
Avec Rank, Femi Iromini simplifie l’épargne et les paiements en Afrique