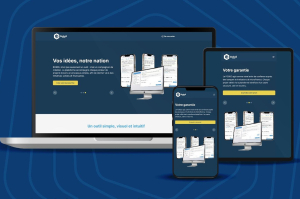Burkina Faso : 370 localités connectées et un contrat d’objectifs réalisé à 91%
Avec plus de neuf objectifs sur dix atteints en 2025, le ministère burkinabè chargé du numérique présente un bilan solide. Connectivité, services publics en ligne et inclusion numérique figurent au cœur des avancées, alors que de nouveaux chantiers structurants sont annoncés pour 2026.
Le Burkina Faso a enregistré une avancée significative dans la mise en œuvre de son contrat d’objectifs 2025, avec un taux de réalisation de 91 % au sein du ministère de la Transition digitale, des Postes et des Communications électroniques. Ces résultats ont été présentés lors de la séance d’évaluation tenue le mardi 3 février, sous la présidence du Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo.
Selon le communiqué officiel du ministère, l’année 2025 aura été une année « charnière » pour le département chargé de la transition digitale et des postes, tant par l’ampleur des chantiers engagés que par les résultats concrets obtenus. En matière de connectivité, 370 nouvelles localités ont été raccordées au réseau de téléphonie, offrant pour la première fois à leurs populations un accès effectif aux services de téléphonie et à Internet, contribuant ainsi à la réduction de la fracture numérique.
Au-delà de l’extension de la connectivité, plusieurs réalisations structurantes ont marqué l’année écoulée. La modernisation de l’administration publique s’est accélérée avec 272 plateformes de services en ligne développées ou en cours de déploiement, dont 146 déjà opérationnelles, facilitant l’accès des citoyens et des entreprises aux services publics. Sur le plan de l’inclusion numérique, un contrat d’objectifs entre l’État et La Poste a été signé pour la construction de 20 « Zama Tchéy » ou Maisons du citoyen, destinées à accompagner notamment les populations les plus vulnérables dans l’utilisation des services numériques.
Pour 2026, le ministère entend capitaliser sur ces acquis. Les priorités incluent la mise en place d’un système d’enrôlement pour l’identification unique électronique de la personne, avec l’objectif d’enregistrer sept millions de personnes d’ici la fin de l’année. La poursuite du chantier « zéro zone blanche », avec la couverture de 750 nouvelles localités, la construction d’un réseau dédié à l’administration publique, ainsi que le développement d’outils nationaux de messagerie et de collaboration numériques, figurent également parmi les actions prévues.
Parallèlement, un centre de supervision des infrastructures numériques a été lancé en janvier 2026 afin de renforcer la capacité du pays à protéger et à gérer ses systèmes numériques critiques. Pour la mise en œuvre de l’ensemble de ces projets, le ministère a mobilisé un budget de 61 milliards de francs CFA, soit environ 109,7 millions de dollars.
Malgré ces avancées, le Burkina Faso reste confronté à des défis structurels, notamment en matière de pénétration d’Internet et d’accès équitable à des services numériques de qualité sur l’ensemble du territoire. Selon DataReportal, le pays comptait 5,42 millions d’utilisateurs d’Internet à la fin de 2025, pour un taux de pénétration de 22,4 %. À la même période, 29,3 millions de connexions mobiles étaient actives, soit 121 % de la population totale, illustrant un important potentiel de développement des usages numériques.
Samira Njoya
Edité par Sèna D. B. de Sodji
Lire aussi:
Numérique : des investisseurs égyptiens prospectent le marché burkinabé
Burkina Faso : 109 millions de dollars pour les projets numériques en 2026
Google lance WAXAL, une base de données vocales qui met l’IA au service de 21 langues africaines
En donnant accès à des ressources vocales multilingues, Google veut favoriser l’émergence d’outils d’IA adaptés aux réalités locales, avec des applications potentielles dans l’éducation, la mobilité, les services financiers et la communication numérique.
Google a annoncé lundi 2 février le lancement de WAXAL, une base de données vocale conçue pour faciliter le développement de technologies d’intelligence artificielle adaptées à l’Afrique subsaharienne. L’ensemble des données couvre 21 langues, dont le yoruba, acholi, hausa, luganda, malagasy et shona, et contient plus de 11 000 heures d’enregistrements audio provenant de près de 2 millions d’enregistrements individuels.
« Nous voulions capturer la façon dont les gens parlent vraiment, alors nous avons demandé aux participants de décrire différentes images dans leur langue maternelle. Nous avons également enregistré des acteurs vocaux professionnels en studio pour créer l’audio de haute qualité nécessaire à la technologie du texte à la parole », a expliqué Google dans un communiqué.
Selon Google, WAXAL comprend 1 250 heures de discours transcrits pour la reconnaissance automatique de la parole et plus de 20 heures d’enregistrements studio pour la synthèse vocale (text-to-speech). La collecte a été réalisée en collaboration avec des partenaires africains, notamment l’Université Makerere en Ouganda, l’Université du Ghana et Digital Umuganda au Rwanda. Des experts régionaux ont assuré la qualité des enregistrements pour les applications professionnelles.
La mise à disposition de WAXAL se fait en licence ouverte sur la plateforme Hugging Face, ce qui permet aux chercheurs et développeurs d’accéder librement aux données. L’objectif affiché est double : stimuler l’innovation dans les technologies vocales en Afrique et contribuer à la préservation numérique des langues locales.
Selon les estimations de l’UNESCO, l’Afrique compte entre 1500 et 3000 langues distinctes, mais la majorité des outils numériques ne prend en charge que quelques langues principales. L’absence de données de qualité constitue un frein majeur à l’essor des assistants vocaux, des applications éducatives ou des outils de transcription automatique sur le continent.
Outre WAXAL, plusieurs projets locaux en Afrique cherchent à combler le déficit de données vocales. Au Bénin, l’initiative « JaimeMaLangue » mobilise les citoyens pour construire une base nationale en langues locales ; des jeux de données comme African Voices (Nigeria) ou African Next Voices (Mali) enrichissent les corpus pour des langues sous-représentées. Des programmes universitaires en Afrique de l’Est développent des ressources pour le luganda, le swahili et d’autres langues, contribuant ainsi à un écosystème plus robuste pour les technologies vocales africaines.
Samira Njoya
Lire aussi:
Le Bénin lance un projet d’IA pour donner une existence numérique aux langues locales
Afrique du Sud : la SABC forme aux compétences numériques
Les compétences numériques sont considérées comme un socle de la transformation numérique. Par exemple, il est estimé à environ 230 millions le nombre d’emplois qui nécessiteront des compétences numériques d’ici 2030.
La South African Broadcasting Corporation (SABC), le radiodiffuseur public sud‑africain, s’est associée à Microsoft South Africa pour former les citoyens aux compétences numériques et à l’intelligence artificielle (IA). Les contenus de formation seront diffusés via SABC Plus, une plateforme de streaming gratuite qui revendique plus de 1,9 million d’utilisateurs enregistrés.
« L’IA peut être un puissant vecteur d’opportunités. En nous associant à la SABC, nous visons à intégrer les compétences numériques et en IA dans le quotidien de millions de Sud‑Africains. Cette initiative permet aux apprenants, aux enseignants et aux demandeurs d’emploi d’accéder à des parcours pratiques et certifiés qui les préparent à la main‑d’œuvre de demain. Démocratiser les compétences en IA n’est pas seulement un objectif, c’est notre responsabilité pour façonner une économie numérique plus inclusive », a déclaré Tiara Pathon, directrice des compétences IA pour Microsoft Elevate en Afrique du Sud.
Cette initiative s’inscrit dans le cadre du programme Microsoft Elevate, qui vise à doter les individus et les organisations des compétences et outils nécessaires pour prospérer dans une économie axée sur l’IA. Elle prolonge également l’AI Skills Initiative, lancée en 2025, par laquelle Microsoft s’était engagé à former un million de Sud‑Africains d’ici 2026. À ce jour, le groupe indique avoir touché 4 millions d’apprenants, formé 1,4 million de personnes et délivré des certifications à près de 500 000 citoyens, illustrant l’ampleur de l’impact déjà enregistré.
Le programme intervient dans un contexte de transformation numérique marqué par une demande croissante en compétences numériques sur le marché du travail. Selon la Banque mondiale, 230 millions d’emplois nécessiteront des compétences numériques en Afrique subsaharienne d’ici 2030. Microsoft s’appuie également sur le Future of Jobs Report 2025 du Forum économique mondial, qui classe les compétences en IA et en données parmi les plus recherchées à l’horizon 2030. LinkedIn indique de son côté que les recrutements liés à l’IA ont progressé de 25 % sur un an, tandis que les offres d’emploi exigeant une maîtrise de l’IA ont augmenté de 70 %, bien au‑delà des seuls profils techniques.
En Afrique du Sud, le AI Diffusion Report de Microsoft montre que l’adoption de l’IA est passée de 19,3 % au premier semestre 2025 à 21,1 % au second, soit une hausse de 1,8 point. La plateforme de recrutement Pnet souligne par ailleurs que la demande en compétences liées à l’IA dans la nation arc‑en‑ciel a progressé de 352 % entre janvier 2019 et juillet 2025.
Cette initiative soulève toutefois des interrogations quant à son efficacité réelle. Sur les 1,9 million d’utilisateurs enregistrés sur SABC Plus, seulement 25 % sont actifs, ce qui limite mécaniquement la portée effective du programme. En outre, si l’accès à la plateforme est gratuit, son utilisation suppose une connexion Internet, encore inégalement accessible, notamment pour les populations vivant dans des zones mal couvertes ou disposant de moyens financiers limités. Enfin, les personnes ne disposant pas d’équipements numériques adaptés restent de facto exclues du dispositif.
Isaac K. Kassouwi
Lire aussi:
Afrique du Sud : un appui de 290 593 $ aux fournisseurs d’Internet locaux
L’Afrique du Sud teste une super-application pour faciliter les services publics
RDC : le Fogec mise sur le numérique pour accompagner les porteurs de projets
Dans plusieurs pays africains, l’accès au financement demeure l’un des principaux obstacles à la concrétisation des projets entrepreneuriaux. Parmi les facteurs en cause figurent la faiblesse du montage des dossiers et la complexité des procédures.
Le Fonds de garantie de l’entrepreneuriat au Congo (Fogec) a lancé, le mardi 3 février à Kinshasa, une plateforme numérique dédiée à l’élaboration des plans d’affaires et à la dématérialisation du processus de soumission des dossiers de financement. Baptisée Bokeli, l’initiative s’inscrit dans les efforts des autorités congolaises pour améliorer l’accompagnement des porteurs de projets et renforcer l’accès des PME et des start‑up au crédit.
Accessible via l’adresse https://bokeli.fogec.cd/, la plateforme permet aux entrepreneurs de structurer leurs projets à travers des outils numériques dédiés à la conception de business plans, à la préparation des dossiers financiers et à leur transmission aux structures concernées. Elle vise notamment à standardiser les informations requises par les institutions financières et à réduire les contraintes administratives qui freinent l’instruction des demandes de financement.
À travers ce dispositif, le Fogec entend répondre à l’un des principaux obstacles identifiés dans l’écosystème entrepreneurial congolais : la difficulté pour de nombreux porteurs de projets à présenter des dossiers techniquement solides et conformes aux exigences des banques et des mécanismes de garantie. L’institution rappelle que sa mission consiste à faciliter l’accès au financement des PME, des start‑up et des artisans, en apportant des garanties aux projets jugés viables, dans un contexte où l’insuffisance de garanties reste un frein majeur au crédit bancaire.
Cette initiative intervient dans un environnement marqué par une montée progressive de l’entrepreneuriat, portée notamment par une population jeune de plus en plus engagée dans la création d’activités économiques. Toutefois, le dynamisme entrepreneurial peine encore à se traduire par des financements structurés. Selon les données de Partech Africa, qui recense les opérations de levées de fonds supérieures à 100 000 USD sur le continent, les start‑up de la RDC ont levé 2 millions USD en 2024, après 1 million USD en 2023, des montants qui restent modestes au regard du potentiel du marché congolais. Du côté du Fogec, en cinq années d’existence, l’institution revendique l’accompagnement de près de 300 projets pour un montant global avoisinant 3,2 millions USD.
Dans ce contexte, les difficultés liées à la formalisation des projets, à la qualité des plans d’affaires et à la complexité des procédures figurent parmi les facteurs régulièrement cités par les acteurs du secteur financier. En mettant à disposition un outil numérique dédié à ces étapes clés, le Fogec cherche à renforcer la bancabilité des projets et à fluidifier l’interaction entre entrepreneurs, structures de garantie et institutions financières, dans l’objectif de soutenir plus efficacement le développement du tissu productif national.
Samira Njoya
Algérie : la Bourse supprime les frais d’introduction pour les start‑up jusqu’en 2028
Alors que les start‑up algériennes peinent encore à accéder à des financements privés structurés, les autorités boursières misent sur un levier inédit pour rapprocher l’écosystème entrepreneurial du marché financier.
Les start‑up labellisées peuvent lever des fonds à la Bourse d’Alger sans payer les frais d’introduction, grâce à un dispositif exceptionnel valable jusqu’en 2028. La mesure a été annoncée le dimanche 1ᵉʳ février par la Commission d’Organisation et de Surveillance des Opérations de Bourse (COSOB), en coordination avec la Société de Gestion de la Bourse des Valeurs (SGBV) et Algérie Clearing.
Le mécanisme cible les opérations réalisées via le compartiment « Croissance », un segment du marché des titres de capital destiné aux entreprises à fort potentiel. Les start‑up éligibles bénéficient d’une exonération totale des frais liés à l’obtention du visa sur les documents d’information, à l’admission à la cote, ainsi qu’à l’administration, la conservation et la gestion des titres.
Le dispositif s’applique aux levées de fonds plafonnées à 500 millions de dinars algériens (3,85 millions USD) et couvre toutes les opérations engagées entre 2026 et 2028. En supprimant ces coûts d’entrée, souvent dissuasifs pour les jeunes entreprises, les autorités cherchent à lever un frein majeur à l’accès au marché boursier comme source de financement alternatif. Le paysage entrepreneurial algérien compte aujourd’hui plus de 7800 start‑up enregistrées sur le portail officiel startup.dz, dont environ 2300 ont obtenu le label officiel « start‑up ».
Cette initiative s’inscrit dans une stratégie plus large de soutien à l’entrepreneuriat et à l’innovation, présentés par les pouvoirs publics comme des leviers essentiels de diversification de l’économie nationale. Elle intervient dans un contexte où la Bourse d’Alger reste de taille modeste, avec seulement huit titres cotés à la fin du premier semestre 2025, incluant les récentes introductions de la Banque de Développement Local (BDL) et de la start‑up Moustachir.
À ce jour, Moustachir demeure la seule start‑up algérienne à avoir accédé à la cote. Introduite en 2024, l’entreprise avait fixé des objectifs ambitieux : un chiffre d’affaires supérieur à 55 millions de dinars en 2025, avec une trajectoire projetée au‑delà de 187 millions de dinars à l’horizon 2028. En moins de deux ans, la start‑up s’est déjà implantée sur plusieurs marchés du Moyen‑Orient, notamment à Oman et aux Émirats arabes unis.
Samira Njoya
Edité par Sèna D. B. de Sodji
Lire aussi:
L’Algérie se dote d’un cadre institutionnel renforcé pour prévenir les cyberattaques
Gabon : vers la mise en place d’un cadre juridique pour l’archivage numérique
Les autorités poursuivent les efforts en faveur de la transformation numérique. L’exécutif a adopté en septembre 2025 un cadre légal pour la numérisation des services publics.
Le gouvernement gabonais veut mettre en place un cadre juridique pour l’archivage numérique dans le pays. L’initiative a fait l’objet d’un projet d’ordonnance adopté le jeudi 29 janvier, lors du Conseil des ministres.
Selon les autorités, l’initiative s’inscrit dans la politique nationale d’archivage et fixe les principes et règles applicables à la constitution, conservation, gestion et valorisation des documents électroniques et numériques. Elle encadre également l’activité des prestataires de services de dématérialisation et de conservation des archives électroniques.
Le ministère de l’Économie numérique explique que cette mesure permet notamment la création, conservation et sécurisation des documents administratifs sous forme numérique ; une meilleure organisation et protection des archives de l’État ; une régulation des prestataires de numérisation et de conservation.
Cette initiative s’inscrit dans les ambitions de transformation numérique du Gabon. Alors que les autorités veulent intégrer le numérique à tous les secteurs d’activité, l’archivage numérique est censé garantir plus d’efficacité, moins de pertes de données et plus de transparence, notamment dans l’administration publique.
Depuis juillet 2025, le gouvernement explore des solutions locales pour la gestion électronique des documents administratifs, s’étant rapproché d’entreprises comme CompanyViene et ST Digital. Début décembre, un atelier avait réuni les acteurs du secteur pour jeter les bases d’un système intégré et sécurisé d’archivage des actes judiciaires, afin d’améliorer leur traitement et leur accessibilité aux citoyens.
La digitalisation des archives pose toutefois plusieurs interrogations, notamment celles liées à la sécurité, dans un contexte de recrudescence des cyberattaques et de la cybercriminalité en Afrique. Le Gabon fait partie des pays les moins avancés en matière de cybersécurité, selon le Global Security Index 2024 de l’Union internationale des télécommunications (UIT). L’organisation estime que le pays a mis en place un cadre légal favorable à la cybersécurité, ayant obtenu le score maximal (20/20) dans ce volet. Cependant, il présente des lacunes en ce qui concerne l’organisation, le développement des capacités, la coopération et les mesures techniques. Pour ce volet, le pays affiche un score de 0/20.
Isaac K. Kassouwi
Edité par Sèna D. B. de Sodji
Lire aussi:
Le Gabon adopte un cadre légal pour accélérer la numérisation des services publics
Le Cap-Vert lance un programme pour former les jeunes au numérique
Selon la Banque mondiale, environ 230 millions d’emplois nécessiteront des compétences numériques d’ici 2030. Cette évolution soutient la transformation numérique en cours sur le continent.
Le gouvernement capverdien a lancé, la semaine dernière, le programme « Skodji Digital » pour former jusqu’à 3000 jeunes aux compétences numériques. D’un coût de 400 000 euros (environ 477 000 dollars), cette initiative vise à permettre aux jeunes de participer à l’économie mondiale du travail indépendant « gig economy », d’accéder à des opportunités de travail à distance et de développer des micro‑entreprises numériques.
Dans sa première phase, le programme soutiendra directement 1050 participants, dont des jeunes résidant sur le territoire national et au sein de la diaspora. Les candidatures sont déjà ouvertes et le resteront jusqu’au 25 février, via une plateforme dédiée, tandis que la phase de formation, selon son type, aura une durée variable comprise entre deux et six mois.
« Skodji Digital prévoit une formation structurée en compétences numériques alignées sur la demande du marché mondial, un accès accompagné aux plateformes internationales d’emploi numérique et de travail indépendant, l’activation de carrières dans des secteurs numériques émergents ainsi que des parcours dédiés à l’entrepreneuriat numérique et à la création de micro‑initiatives entrepreneuriales », peut‑on lire dans un communiqué du gouvernement.
Cette démarche s’inscrit dans la stratégie numérique du Cap‑Vert, qui repose sur l’expansion des services numériques, l’attraction d’entreprises internationales, l’accueil de travailleurs à distance et l’investissement dans les compétences locales. Le pays s’est notamment rapproché du Portugal afin de devenir un vivier de talents numériques pour les entreprises portugaises. Les deux parties entendent renforcer leur coopération pour la mise en place d’une offre de formation alignée sur les besoins du marché et dans la création d’un environnement favorable à l’expérimentation de solutions technologiques.
Cette initiative du gouvernement capverdien constitue aussi un levier pour l’emploi. Le pays dispose d’une population d’environ 600 000 habitants, majoritairement jeune, selon la Banque africaine de développement (BAD). L’institution financière indique que le taux global de chômage est de 14,5 %. Chez les jeunes, il grimpe à 27,8 %, à raison de 33,4 % pour les femmes et 22,9 % pour les hommes.
Il convient toutefois de rappeler que le développement de la gig economy ainsi que le travail à distance nécessitent, entre autres, un accès de qualité à Internet. Selon l’Union internationale des télécommunications (UIT), le taux de pénétration d’Internet dans le pays était de 73,5 % en 2023.
Isaac K. Kassouwi
Lire aussi:
Start-up : le Cap-Vert accélère le développement de son écosystème numérique
L’île Maurice déploie l’IA générative dans ses écoles
La République mauricienne fait partie des meilleurs élèves africains en matière d’IA. Selon le Government AI Readiness Index du cabinet britannique Oxford Insights, Maurice affichait en 2024 un score de 53,94 sur 100, se classant premier en Afrique subsaharienne.
Maurice intègre l’intelligence artificielle générative dans son système éducatif avec le lancement de mytGPT Education, un assistant pédagogique développé par Mauritius Telecom et le ministère de l’Éducation. L’outil, officiellement lancé le lundi 26 janvier, vise à moderniser les pratiques d’apprentissage et d’enseignement à l’échelle nationale.
« La mise en œuvre de mytGPT Education dans les écoles s’inscrit pleinement dans notre stratégie, dont l’objectif est de faire de l’intelligence artificielle un outil au service du progrès national, accessible à tous. À travers ce projet, chaque enfant à Maurice pourra disposer d’un accompagnateur pédagogique IA capable de soutenir son apprentissage », a déclaré Veemal Gungadin, CEO de Mauritius Telecom.
Concrètement, mytGPT Education repose sur des technologies d’IA générative conçues pour fournir un accompagnement pédagogique personnalisé aux élèves. La plateforme propose des explications adaptées au niveau de chaque apprenant, des exercices interactifs ainsi qu’un contenu sécurisé disponible en anglais, français et créole phonétique. Pour les enseignants, l’outil permet d’automatiser la production de quiz et de supports pédagogiques, tout en intégrant des fonctionnalités d’analyse des performances scolaires, susceptibles d’orienter plus finement les stratégies d’enseignement.
Le projet est déployé, dans un premier temps, sur une base pilote auprès des élèves des Grades 4, 7, 8 et 9, dans huit établissements scolaires, comprenant quatre écoles primaires et quatre collèges d’État répartis sur l’ensemble du territoire. Plus de 50 ressources pédagogiques, alignées sur le National Curriculum Framework, ont déjà été intégrées à la plateforme. En parallèle, des sessions de formation organisées entre décembre 2025 et janvier 2026 ont permis de sensibiliser les enseignants aux fondamentaux de l’intelligence artificielle, à l’usage de la plateforme et aux bonnes pratiques liées au prompt engineering.
À travers cette expérimentation, Maurice s’inscrit dans une tendance mondiale visant à explorer le potentiel de l’IA générative appliquée à l’éducation, un segment encore émergent dans les pays africains. Si le projet ouvre la voie à une personnalisation accrue des apprentissages et à une optimisation des ressources pédagogiques, son passage à l’échelle dépendra de plusieurs facteurs clés : la robustesse technologique de la plateforme, son intégration avec les systèmes éducatifs existants, la gouvernance des données scolaires et la capacité du système éducatif à accompagner durablement les enseignants dans l’appropriation de ces nouveaux outils numériques.
Samira Njoya
Edité par Sèna D. B. de Sodji
Lire aussi:
Maurice accélère la numérisation de son système de santé avec le projet « E-Health »
Maroc : trois accords signés pour renforcer l’offshoring numérique
Dans un contexte de forte concurrence entre hubs africains du numérique, le royaume mise sur des partenariats ciblés pour consolider son attractivité auprès des acteurs internationaux de l’offshoring.
Le Maroc a procédé, le mardi 27 janvier à Rabat, à la signature de trois accords destinés à renforcer l’écosystème de l’offshoring numérique. Conclus en marge d’une rencontre dédiée au renouvellement de l’offre nationale du secteur, ces partenariats visent à soutenir la formation, l’attractivité territoriale et l’implantation de projets à forte valeur ajoutée.
Les conventions portent notamment sur le déploiement de la prime à la formation, conçue comme un levier d’adaptation des compétences aux besoins des entreprises du numérique. Elles prévoient également le développement des Tech Valleys Offshoring, à travers la création de pôles économiques spécialisés intégrant infrastructures technologiques, services mutualisés et espaces dédiés à l’accueil d’investissements nationaux et internationaux.
Se repositionner dans le marché mondial
La signature de ces accords intervient dans un contexte de transformation accélérée du marché mondial de l’offshoring, marqué par la digitalisation des services, l’essor du cloud, de la data et de l’intelligence artificielle. Dans ce nouvel environnement, les destinations historiques sont désormais en concurrence avec des hubs émergents, notamment en Afrique. Le Maroc cherche ainsi à consolider son positionnement en misant sur une offre plus structurée, davantage orientée vers les métiers numériques et les services à forte valeur ajoutée.
Un secteur clé de l’économie numérique
L’offshoring s’impose aujourd’hui comme l’un des principaux contributeurs aux exportations de services du royaume. À fin 2024, le secteur comptait près de 148 500 emplois et générait plus de 26,2 milliards de dirhams (≈2,8 milliards USD) de recettes à l’export. Cette dynamique s’accompagne d’une évolution progressive des activités, avec un recul des centres d’appels traditionnels au profit des services IT, de l’ingénierie et des fonctions digitales spécialisées. Les autorités marocaines visent, à l’horizon 2030, un doublement des performances du secteur, avec un objectif de 270 000 emplois et près de 40 milliards de dirhams d’exportations.
Des accords pour renforcer la compétitivité
À travers ces partenariats, le gouvernement entend renforcer la compétitivité de l’offre « Made in Morocco » sur le marché mondial des services numériques. La montée en compétences des talents, la structuration de pôles territoriaux spécialisés et la visibilité offerte aux investisseurs constituent les principaux leviers attendus.
À terme, ces accords pourraient contribuer à attirer de nouveaux projets technologiques, soutenir l’emploi qualifié et renforcer la place du Maroc comme plateforme régionale de services numériques destinés aux marchés européen et africain.
Samira Njoya
Edité par Sèna D. B. de Sodji
Lire aussi:
Intelligence artificielle : le Maroc trace sa feuille de route jusqu’en 2030
Nigeria : le président Tinubu approuve l’acquisition de deux nouveaux satellites télécoms
Le Nigeria se présente comme le seul pays d’Afrique de l’Ouest à disposer d’un satellite de communications opérationnel. Mais cette infrastructure approche progressivement de la fin de sa vie.
Les autorités nigérianes avancent vers leur objectif d’acquérir deux nouveaux satellites télécoms afin de renforcer l’infrastructure numérique nationale. Le président de la République, Bola Ahmed Tinubu, a approuvé l’initiative, selon le ministre des Communications, de l’Innovation et de l’Économie numérique, Bosun Tijani, cité par la presse locale.
M. Tijani a fait cette annonce le mercredi 28 janvier à Abuja, lors d’une conférence de presse organisée à l’occasion de la Journée mondiale de la protection de la vie privée, par la Commission nigériane de protection des données.
Les deux nouveaux satellites sont destinés à remplacer le NigComSat‑1R, seul satellite de communications exploité par le Nigeria depuis décembre 2011. Celui‑ci avait été lancé pour succéder au NigComSat‑1, mis en orbite le 13 mai 2007 avec l’appui de la Chine, mais perdu peu après son lancement. Conçu pour une durée de vie de 15 ans, le NigComSat‑1R devait atteindre sa fin de vie en 2026. Le gouvernement a toutefois annoncé, en septembre 2025, la prolongation de son exploitation jusqu’en 2028.
Selon le ministre, l’acquisition de nouveaux satellites s’inscrit pleinement dans les ambitions de transformation numérique du Nigeria. Il a rappelé que le pays poursuit parallèlement le déploiement de 90 000 km de fibre optique, un projet déjà achevé à 60 %. La technologie numérique occupe une place centrale dans la stratégie du président Tinubu visant à bâtir une économie de 1000 milliards USD. Les satellites peuvent notamment contribuer à élargir l’accès aux TIC dans un pays où la GSMA estime à 120 millions le nombre de personnes non connectées à l’Internet mobile fin 2023, sur une population de 223,8 millions d’habitants.
Dès 2016, le gouvernement nigérian avait exprimé sa volonté de se doter de deux nouveaux satellites télécoms, évaluant le coût du projet à environ 500 millions USD. L’exécutif indiquait alors négocier un prêt avec la Banque d’export‑import de Chine (China Eximbank), sur le modèle du financement du premier satellite.
Toutefois, Jane Nkechi Egerton‑Idehen, directrice générale de Nigerian Communications Satellite Limited (NigComSat), expliquait dans une interview accordée à TechCabal en septembre 2025 que ce schéma n’est plus l’unique option. Selon elle, le processus est désormais ouvert, et plusieurs fournisseurs et investisseurs ont soumis des offres.
Au‑delà de la question financière, Mme Egerton‑Idehen souligne que le Nigeria cherche aussi à préserver ses créneaux orbitaux, c’est‑à‑dire les positions réservées à chaque pays pour le déploiement de satellites. Le NigComSat‑1R occupe actuellement l’un des trois créneaux attribués au Nigeria par l’Union internationale des télécommunications (UIT).
Isaac K. Kassouwi
Lire aussi:
Lutte contre l’exploitation minière illégale : le Nigeria mise sur la technologie spatiale
Internet par satellite : Amazon autorisé à entrer sur un marché nigérian dominé par Starlink