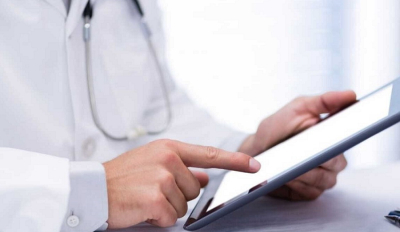Tech (1313)
Les autorités sénégalaises prévoient d’accélérer la transformation numérique en 2026. De nombreux projets sont déjà en cours pour moderniser les services publics, renforcer la connectivité et développer l’économie numérique.
À l’occasion de la revue du portefeuille de la Banque mondiale au Sénégal, le ministre de la Communication, des Télécommunications et du Numérique a reçu, le jeudi 12 février à Dakar, le vice‑président de la Banque mondiale pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre, Ousmane Diagana, en tournée dans le pays avec ses équipes. La rencontre a été l’occasion de présenter la vision intégrée du numérique portée par les autorités sénégalaises et d’examiner les grands axes du New Deal technologique, la feuille de route nationale pour la transformation digitale.
Au cœur des discussions, le Projet d’Accélération de l’Économie Numérique au Sénégal (PAENS), récemment aligné sur l’agenda national. Après plusieurs mois de structuration approfondie, le projet intègre désormais des priorités concrètes, notamment le déploiement du système intégré de gestion des finances publiques, le renforcement des capacités en cybersécurité, la mise en place d’un Cloud gouvernemental souverain et le développement de cas d’usage dans l’IA.
Au‑delà des orientations, les échanges ont permis d’acter des étapes opérationnelles concrètes attendues au premier semestre 2026. Parmi elles figurent le lancement de l’appel d’offres pour la connexion des zones blanches, notamment dans le bassin arachidier et la basse Casamance, le démarrage des travaux pour le module comptable intégré du SIGIF, et le déploiement du dossier patient informatisé, financé dans le cadre du PAENS.
Un budget en nette progression pour soutenir le numérique
Pour soutenir ces objectifs, le Sénégal a renforcé l’allocation budgétaire dédiée au numérique. Le budget du ministère du Numérique pour 2026 s’élève à 81,06 milliards de francs CFA (environ 146 millions USD), soit une hausse de près de 38,7 % par rapport à 2025. Près de 60 % de cette enveloppe est dédiée à l’investissement, notamment dans les infrastructures, la cybersécurité et le développement de l’économie numérique.
L’ensemble de ces initiatives s’inscrit pleinement dans le cadre du New Deal technologique lancé en février 2026 par les autorités sénégalaises, qui vise à faire du numérique un moteur de souveraineté et de développement. Dans ce contexte, le PAENS bénéficie d’un soutien conséquent de la Banque mondiale, avec une enveloppe de 95,05 milliards de francs CFA, destinée entre autres à renforcer l’environnement juridique, réglementaire et institutionnel de l’économie numérique, développer la connectivité à large bande et favoriser l’inclusion numérique, tout en soutenant l’adoption du numérique dans les services publics, notamment à travers la santé digitale.
Samira Njoya
Edité par Sèna D. B. de Sodji
Lire aussi:
Sénégal : le Parc des technologies numériques opérationnel dès mars 2026 (ministre)
Face aux enjeux sociaux et environnementaux croissants, l’innovation technologique portée par les jeunes entrepreneurs gagne du terrain en Afrique et au Moyen-Orient. À travers le concours Orange Summer Challenge, le groupe Orange soutient l’émergence de solutions à impact et accompagne leur développement.
Le concours international Orange Summer Challenge, dédié à l’entrepreneuriat responsable en Afrique et au Moyen-Orient, a dévoilé les lauréats de la finale de sa 3ᵉ édition organisée le 4 février à Casablanca, au Maroc. Trois start-up ont été distinguées pour leur potentiel d’impact dans des domaines liés à la sécurité au travail, à l’énergie durable et à la gestion des ressources en eau.
La start-up jordanienne SafeGuard a remporté le premier prix grâce à un dispositif intelligent de prévention des accidents professionnels basé sur la détection des risques. La malgache GasNika s’est classée deuxième avec une solution de production de biogaz à partir de déchets organiques, valorisés en fertilisant biologique. La tunisienne DripIn complète le podium avec une solution connectée utilisant l’intelligence artificielle pour détecter les fuites d’eau et optimiser la consommation.
Les lauréats bénéficieront d’un accompagnement financier, technique et commercial assuré par le réseau des Orange Digital Centers, ainsi que d’une dotation globale de 50 000 euros destinée à accélérer le développement de leurs projets.
Pour l’édition 2025, 369 jeunes innovateurs issus de 14 pays ont suivi un programme d’accompagnement intensif combinant formation, mentorat et coaching, déployé par Orange Afrique et Moyen-Orient avec l’appui de partenaires technologiques et institutionnels, dont Amazon Web Services, Meta, le Programme des Nations Unies pour le développement, The Hashgraph Association et Dar Blockchain. Au total, 56 projets ont émergé autour de la thématique Startup4Good, dans des secteurs tels que l’environnement, la santé, l’éducation et l’agriculture.
Selon Ben Cheick Haidara, directeur général adjoint et directeur des opérations d’Orange Afrique et Moyen-Orient, cette édition illustre l’ambition du groupe de faire des Orange Digital Centers des plateformes d’innovation ouvertes, orientées vers des solutions technologiques à impact social et environnemental. « Bien plus qu’une compétition, ce programme permet aux jeunes entrepreneurs de développer des solutions technologiques, notamment basées sur l’intelligence artificielle, pour répondre concrètement aux défis sociétaux et environnementaux. À travers les Orange Digital Centers, Orange s’engage durablement aux côtés de la jeunesse pour faire émerger une innovation à fort impact en Afrique et au Moyen-Orient », a-t-il souligné.
Samira Njoya
Edité par Sèna D. B. de Sodji
Lire aussi:
Les cinq start-up lauréates du POESAM 2025 sont désormais connues
Les autorités algériennes ont entamé depuis plusieurs années la numérisation des services judiciaires. Plusieurs fonctionnalités sont déjà disponibles, comme la consultation des affaires, le retrait électronique des copies de jugements ou l’accès au casier judiciaire.
Le ministre algérien de la Justice, garde des Sceaux, Lotfi Boudjemaâ, a annoncé le dimanche 15 février depuis la Cour de Biskra le lancement d’une plateforme numérique permettant aux avocats de demander et retirer en ligne les copies exécutoires des jugements et décisions de justice. L’initiative vise à simplifier les démarches et à réduire les déplacements physiques vers les tribunaux.
La plateforme offre aux avocats la possibilité de déposer leurs demandes de « grosses » issues des juridictions ordinaires et administratives et de récupérer les documents signés électroniquement. Chaque demande est traitée automatiquement et mise à disposition dans un délai maximum de 24 heures. Selon le ministre, ce dispositif contribue à moderniser le fonctionnement des juridictions et à améliorer la réactivité des services destinés aux professionnels du droit et aux justiciables. L’accès se fait via le compte électronique de chaque avocat sur l’interface numérique d’échange de requêtes et de mémoires du ministère.
Cette initiative s’inscrit dans une dynamique plus large de digitalisation des services judiciaires en Algérie. Depuis mai 2024, un guichet électronique national permet déjà le suivi des affaires et le retrait des copies simples de jugements et arrêts depuis n’importe quelle juridiction du pays, réduisant délais et déplacements pour les justiciables et leurs avocats.
À l’instar de l’Algérie, plusieurs pays africains ont engagé la modernisation numérique de leurs systèmes judiciaires. Au Maroc, les plateformes numériques permettent aux avocats de déposer des documents électroniquement, de suivre l’avancée des procédures et d’accéder à certains actes comme les extraits de casier ou décisions de justice. Au Rwanda, le système intégré de gestion électronique des dossiers (IECMS) assure la numérisation du dépôt des affaires, le suivi des dossiers et la tenue d’audiences virtuelles, rendant les procédures plus accessibles et transparentes pour les justiciables.
Samira Njoya
Edité par Sèna D. B. de Sodji
Lire aussi:
Algérie : lancement du dispositif national de gouvernance des données
Le gouvernement tunisien intensifie ses efforts pour transformer l’administration grâce au numérique. Objectif : rapprocher les services publics des citoyens, améliorer la transparence et créer un cadre propice à l’investissement et à l’innovation.
La Tunisie mise sur 192 projets numériques pour accélérer la modernisation de son administration et engager, dès 2026, la digitalisation complète des services publics. L’annonce a été faite à l’issue d’un conseil ministériel consacré au suivi de la transition numérique, tenu le vendredi 13 février au palais de La Kasbah.
Présidant la réunion, la cheffe du gouvernement, Sarra Zaâfrani Zenzri, a souligné que la transformation numérique constitue un pilier du programme économique et social de l’État. Les autorités entendent renforcer les services en ligne, généraliser le paiement électronique et assurer l’interopérabilité entre les structures publiques, dans le cadre du plan de développement 2026-2030.
Selon l’exécutif, cette modernisation vise à simplifier les procédures administratives, réduire les délais de traitement, améliorer la transparence des transactions et soutenir l’attractivité économique du pays. Elle s’inscrit également dans une stratégie de lutte contre la corruption, la fraude fiscale et les pratiques informelles.
Plusieurs projets structurants étaient déjà opérationnels à fin 2025, dont un portail unifié des services administratifs, le timbre fiscal électronique, le paiement à distance de certaines taxes, la première phase du programme d’hôpital numérique ainsi que des plateformes dédiées aux permis de construire et aux démarches administratives en ligne. D’autres initiatives concernent l’interconnexion des services publics et le développement de solutions numériques à destination des citoyens et des entreprises.
Ces avancées s’appuient sur un niveau d’adoption numérique relativement élevé en Tunisie. Selon le « Digital 2026: Tunisia » de DataReportal, environ 84 % de la population utilise Internet, tandis que les connexions mobiles dépassent 125 % de la population, un contexte favorable à l’essor des services publics en ligne.
Les autorités prévoient de prioriser les projets à impact direct sur les usagers et les investisseurs, tout en renforçant les exigences en matière de cybersécurité et de protection des données. Un plan national de communication devrait accompagner ce chantier afin de favoriser l’appropriation des services numériques par les citoyens.
Samira Njoya
Edité par Sèna D. B. de Sodji
Lire aussi:
Tunisie : Skirora démocratise l’apprentissage en ligne via ses plateformes web et mobile
Le secteur de la santé est au cœur des politiques de développement au Maroc. La numérisation des services dans le domaine constitue un levier clé pour en améliorer l’efficacité, réduire les coûts, et moderniser le suivi des patients à l’échelle nationale.
Le Maroc prévoit de lancer dès fin mars 2026 la phase pilote de la feuille de soins électronique (FSE) à Kénitra, selon la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS). Cette étape vient en prélude à la dématérialisation du traitement des feuilles de soins, dont la généralisation progressive à l’échelle nationale est prévue entre avril et juin, sous réserve de validation des étapes techniques et réglementaires.
La FSE permet notamment aux médecins, pharmaciens et autres professionnels de la santé de transmettre par voie électronique les données relatives aux consultations, examens et prescriptions directement aux organismes d’assurance maladie, sans recourir au dossier papier. Concrètement, chaque prescripteur établit l’ordonnance via son logiciel ou le portail FSE de la CNSS, le patient recevant une prescription comportant un QR code et un numéro FSE unique. Lors de l’exécution des actes, le professionnel n’aura qu’à scanner ce QR code pour accéder au dossier et renseigner les prestations réalisées, assurant ainsi un suivi instantané et sécurisé.
Cette réforme s’inscrit dans un contexte plus large de digitalisation du système sanitaire marocain, visant à améliorer la coordination des soins, à réduire les délais de remboursement et à fiabiliser les données administratives. Elle complète d’autres initiatives comme le Dossier médical partagé (DMP) ou la future carte de santé numérique, qui permettront de centraliser et d’unifier les informations sanitaires pour faciliter l’accès aux soins et générer des économies pour les caisses d’assurance.
Au-delà de la simplification administrative, la FSE prend une dimension stratégique pour l’ensemble du système. Le secteur de la santé représente près de 6 % du PIB marocain, un apport modeste comparé aux pays développés (10 %). Il doit composer avec des coûts administratifs élevés et des délais de remboursement qui pèsent sur les assurés et les professionnels. La FSE permettra de fiabiliser les flux de données, de réduire les contentieux liés aux dossiers papier et de diminuer les coûts de gestion, estimés à plusieurs centaines de millions de dirhams par an pour les caisses d’assurance maladie, tout en modernisant le pilotage et le suivi du système de santé national.
Samira Njoya
Edité par : Feriol Bewa
Lire aussi: Le Maroc consolide son architecture d’e-gouvernement avec Idarati X.0
L’écosystème entrepreneurial égyptien connaît une dynamique soutenue et gagne en visibilité à l’échelle régionale. Dans ce contexte, le gouvernement entend mieux structurer le secteur et centraliser les données afin de disposer d’indicateurs plus précis sur son évolution.
L’Agence pour le développement de l'industrie des technologies de l'information (ITIDA) a procédé, le jeudi 12 février au Caire, au lancement officiel de la version remaniée de la plateforme « Egypt Innovate », présentée comme la première plateforme numérique nationale entièrement intégrée dédiée à l’innovation et à l’entrepreneuriat. L’annonce est intervenue en marge du salon AI Everything Middle East & Africa, organisé au Centre international des expositions d’Égypte, en présence de délégations issues de plus de 30 pays.
La plateforme est développée et exploitée par un consortium conduit par Entlaq, en partenariat avec Robusta et Kamelizer. Cette alliance public-privé ambitionne de structurer un point d’accès unifié reliant start-up, investisseurs, universités, centres de recherche et institutions publiques au sein d’un même environnement numérique.
Selon Ahmed ElZaher, PDG de l’ITIDA, cette nouvelle version s’inscrit dans la stratégie nationale visant à bâtir une économie fondée sur la connaissance, en s’appuyant sur la donnée et les technologies avancées pour soutenir une croissance durable . La plateforme entend faciliter l’accès au financement grâce à une base de données dynamique présentant les modèles économiques et propositions de valeur des jeunes entreprises, tout en renforçant la visibilité de l’écosystème égyptien à l’échelle régionale et internationale.
Un accent particulier est mis sur la production de contenus spécialisés en langue arabe, considérée comme un levier d’inclusion numérique et de montée en compétences locales. Les autorités estiment que la disponibilité de ressources techniques et entrepreneuriales dans la langue maternelle des porteurs de projets contribue à élargir l’accès aux opportunités et à consolider le positionnement de l’Égypte comme pôle régional d’innovation.
Au terme de sa phase pilote, « Egypt Innovate » fédère 780 entités – start-up, investisseurs, incubateurs et centres de recherche – et héberge plus de 3700 contenus sectoriels. La communauté compte également plus de 81 000 utilisateurs inscrits, ainsi qu’un réseau d’experts mobilisés pour accompagner les entrepreneurs.
Sur le plan fonctionnel, la plateforme intègre des outils reposant sur la donnée et l’intelligence artificielle, dont un assistant numérique, une cartographie interactive de l’écosystème, un système de mise en relation automatisé entre start-up et investisseurs, ainsi qu’un centre d’apprentissage proposant formations, mentorat et simulations entrepreneuriales. Un mécanisme d’auto-vérification des données, fondé sur la mise à jour directe par les entités concernées, vise à garantir la fiabilité et l’actualisation des informations publiées.
Elle s’ajoute aux multiples dispositifs déjà déployés pour structurer et financer l’écosystème entrepreneurial égyptien, qui s’impose comme l’un des plus dynamiques de la région. En 2025, les start-up locales ont levé près de 614 millions de dollars en capital-risque et en financement par emprunt, selon le ministère égyptien de la Planification, du Développement économique et de la Coopération internationale. Ce montant illustre l’appétit croissant des investisseurs. Dans ce contexte, « Egypt Innovate » ambitionne de renforcer la coordination entre acteurs et de fluidifier l’accès aux opportunités de financement dans un marché en pleine maturation.
Samira Njoya
Edité par Sèna D. B. de Sodji
Lire aussi:
Égypte : le Parlement prépare une loi sur l’usage des réseaux sociaux par les mineurs
Le Maroc se distingue comme l’un des pays africains les plus avancés dans la numérisation des services publics. Avec plus de 600 services en ligne et une population fortement connectée, le royaume accélère l’inclusion numérique et modernise ses interactions entre citoyens, entreprises et administrations.
Le Maroc accélère la structuration de son écosystème d’e-gouvernement. Huit mémorandums d’entente ont été signés mardi 10 février à Rabat pour lancer la phase opérationnelle du projet « Idarati X.0 », une méta-application appelée à devenir le point d’entrée unifié des services publics numériques.
Porté par le ministère de la Transition numérique et de la Réforme de l’administration, en coordination avec la Commission nationale de contrôle de la protection des données à caractère personnel (CNDP), le projet ambitionne de structurer un véritable écosystème autour d’un wallet numérique national. Cette brique centrale permettra aux citoyens d’accéder, via une interface unique, à plusieurs services administratifs, en s’appuyant sur la carte nationale d’identité électronique (CNIE) comme socle d’authentification.
Les conventions signées engagent notamment le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, le ministère du Transport et de la Logistique, la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS), l’Agence nationale de la sécurité routière (NARSA) ainsi que l’Agence nationale de la conservation foncière, du cadastre et de la cartographie (ANCFCC). D’autres administrations sont également parties prenantes, traduisant une approche transversale fondée sur l’interopérabilité des systèmes.
Pensée comme une méta-application, Idarati X.0 ne se limite pas à agréger des services existants. Elle vise à repenser l’architecture des parcours usagers, à réduire la fragmentation des plateformes publiques et à centraliser les interactions entre l’administration et les citoyens. Le projet doit se déployer en quatre phases — du benchmark initial au chiffrage des investissements (Capex) et des coûts d’exploitation (Opex) — pour une durée estimée à six mois.
La question de la protection des données constitue un axe structurant du dispositif. Les autorités mettent en avant une approche fondée sur les principes de « privacy by design » et de « security by design », intégrant les exigences de conformité réglementaire et de cybersécurité dès la phase de conception technique. La CNDP est associée au processus afin d’assurer l’alignement du projet avec les standards nationaux en matière de confidentialité et de gouvernance des données.
Ce chantier s’inscrit dans la continuité de la stratégie « Maroc Digital 2030 », qui ambitionne d’accélérer la dématérialisation des procédures, de renforcer l’inclusion numérique et d’améliorer la qualité des services publics. En 2024, 600 services publics étaient déjà en ligne : 300 pour les citoyens, 200 pour les entreprises et 100 pour les administrations. Cette dynamique place le Maroc parmi les pays leaders en Afrique en matière de transformation numérique. Le royaume est classé 90ᵉ mondial et 4ᵉ en Afrique à l’Indice de développement de l’e-gouvernement des Nations unies (EGDI) 2024, avec un score de 0,6841 sur 1, supérieur aux moyennes africaine et mondiale.
Le contexte numérique marocain est particulièrement favorable à ce type d’initiative. Selon DataReportal, le royaume comptait plus de 35,3 millions d’internautes à la fin de 2025, soit un taux de pénétration d’environ 92 % de la population, tandis que le nombre de connexions mobiles dépassait 54,9 millions, traduisant une adoption massive du mobile et de l’accès Internet à large échelle.
Samira Njoya
Edité par Sèna D. B. de Sodji
Lire aussi:
Numérique : le Maroc séduit de plus en plus les investisseurs internationaux
Avec l’accélération de la numérisation des services publics, les données s’imposent comme un actif stratégique pour les États. Leur organisation et leur exploitation deviennent essentielles pour améliorer la gouvernance, moderniser l’administration et soutenir la transformation numérique.
Le Premier ministre algérien, Sifi Ghrieb (photo), a officiellement lancé le lundi 9 février le dispositif national de gouvernance des données. Les autorités présentent le projet comme un socle pour la modernisation de l’État et l’accélération de la transformation numérique du pays.
Selon le Premier ministre, ce dispositif constitue un modèle souverain reposant sur la maîtrise, l’organisation et la protection des données, considérées comme des actifs stratégiques. Il doit favoriser la transition d’une gouvernance administrative traditionnelle vers une gouvernance numérique fondée sur l’exploitation de données fiables pour améliorer la prise de décision publique.
Le système prévoit la mise en place d’un cadre juridique, institutionnel et technique destiné à organiser la collecte, le stockage, le partage et l’exploitation des données publiques. Il doit notamment renforcer la sécurité des systèmes d’information, assurer l’interopérabilité entre les administrations et établir une base nationale unifiée des sources de données. L’objectif est de permettre un échange sécurisé et standardisé des informations entre les institutions, afin d’éviter les silos de données et de fiabiliser les statistiques publiques, tout en soutenant le développement de services numériques fondés sur des données centralisées et actualisées.
L’initiative s’inscrit dans la stratégie « Algérie Numérique 2030 », qui vise la modernisation de l’administration et le développement de l’économie digitale. Le pays a déjà engagé plusieurs projets de dématérialisation des services publics et de renforcement des infrastructures numériques, avec notamment la mise en service de cinq centres de données régionaux destinés à l’hébergement et à la sécurisation des informations publiques.
Consacré par le décret présidentiel n° 25‑350 du 30 décembre 2025, le dispositif national de gouvernance des données doit désormais servir de socle à l’exploitation structurée des données publiques. Les autorités attendent de ce cadre une meilleure coordination entre administrations, une fiabilisation des décisions publiques et un environnement réglementaire plus lisible pour les acteurs économiques, alors que les données s’imposent comme un levier central de la transformation numérique et de l’attractivité économique du pays.
Samira Njoya
Lire aussi:
Algérie : vers la création d’un pôle technologique pour moderniser l’administration
Alors que la transformation numérique s’accélère en Afrique, les gouvernements intensifient la numérisation des services publics. D’où la nécessité de garantir la confiance numérique, en particulier à travers des dispositifs d’identification.
Le président de la République de Djibouti, Ismail Omar Guelleh, a procédé, le lundi 9 février, au lancement officiel de la plateforme Mobile ID, en marge de la clôture du Forum national de l’identité numérique, tenu au Palais du Peuple sous son haut patronage.
Conçue pour simplifier et sécuriser l’accès des citoyens aux services publics et privés, Mobile ID permet une authentification électronique via smartphone ou identifiant numérique unique. La plateforme vise à réduire les démarches administratives, à renforcer la transparence des interactions avec l’État et à inscrire Djibouti dans une dynamique d’économie numérique moderne. Parmi les usages prioritaires figurent l’accès aux services d’état civil, les démarches fiscales, l’ouverture de comptes bancaires ou encore la signature électronique de documents officiels.
Au-delà de la simplification des procédures, les autorités entendent faire de Mobile ID un outil d’interopérabilité des données. À terme, des documents tels que le permis de conduire ou certaines informations de santé pourraient être intégrés autour de l’identifiant unique du citoyen. Le ministre de l’Intérieur a illustré cette perspective par la possibilité, pour un médecin urgentiste, d’accéder rapidement aux données médicales essentielles d’un patient via un identifiant biométrique.
Le projet s’inscrit dans une stratégie plus large de modernisation de l’administration publique, dans la continuité d’initiatives comme « Djibouti fondement du Numérique », un programme quinquennal visant à développer les infrastructures haut débit, promouvoir les compétences numériques et renforcer la couverture mobile et Internet sur l’ensemble du territoire. L’initiative intervient dans un contexte d’amélioration progressive de la connectivité. Selon DataReportal, Djibouti comptait 616 000 connexions mobiles cellulaires actives à la fin de 2025 (soit 51,9 % de la population), tandis que 772 000 personnes utilisaient Internet, pour un taux de pénétration de 65 %.
Toutefois, la réussite du projet dépendra largement de la sécurisation des données. Face aux préoccupations liées à la protection de la vie privée, le gouvernement a assuré que les données biométriques des citoyens seront conservées exclusivement par le ministère de l’Intérieur. Les autres institutions y accéderont uniquement via un système d’échange sécurisé de requêtes et de réponses entre serveurs, garantissant, selon les autorités, la souveraineté des données et leur confidentialité.
Samira Njoya
Edité par Sèna D. B. de Sodji
Lire aussi:
Djibouti et la Roumanie explorent une coopération numérique prometteuse
Après avoir posé les bases juridiques de la transformation numérique de son administration, le Gabon accélère sa stratégie digitale. Libreville mise désormais sur des partenariats technologiques pour moderniser l’action publique et optimiser la gestion des données.
Le ministère gabonais de l’Économie numérique a signé, le vendredi 6 février, en marge de discussions de haut niveau organisées à Abu Dhabi, un mémorandum d’entente avec Presight, filiale du groupe technologique émirati G42. L’initiative vise à accompagner la transformation numérique de l’administration publique et de plusieurs services stratégiques de l’État.
À Abu Dhabi, le Gabon a signé trois Mémorandums d’Entente stratégiques dans les secteurs minier, numérique et logistique.
— Présidence de la République Gabonaise (@PresidenceGA) February 6, 2026
Ces accords s’inscrivent dans la vision du Président de la République, S. E. @oliguinguema, visant à accélérer la transformation économique et renforcer… pic.twitter.com/hkZcUEH6bP
Selon les autorités, la coopération portera sur le déploiement de solutions d’intelligence artificielle, d’analytique avancée et de big data. L’objectif est d’améliorer la gestion des données publiques, d’optimiser les services administratifs et de renforcer les capacités d’aide à la décision. Ce type de solutions est généralement utilisé pour moderniser les systèmes d’information de l’État, automatiser certains processus et améliorer la qualité des services rendus aux citoyens et aux entreprises.
Ce partenariat s’inscrit dans un contexte où la transformation numérique constitue l’un des chantiers prioritaires des autorités gabonaises. D’après DataReportal, le pays comptait environ 1,8 million d’utilisateurs d’Internet en 2025, soit près de 71,9 % de la population, tandis que les connexions mobiles dépassaient 3,27 millions. Malgré ces progrès, la digitalisation des services publics et la gestion des données à l’échelle nationale restent des enjeux majeurs pour améliorer l’efficacité administrative et soutenir la diversification économique.
Présente sur plusieurs marchés, la société Presight a déjà noué des partenariats avec des gouvernements et des institutions en Afrique, notamment en Gambie et en Côte d’Ivoire, pour des projets liés à l’intelligence artificielle, à la sécurité ou encore à la gestion des données publiques. L’entreprise, cotée à la Bourse d’Abu Dhabi, se positionne comme un acteur clé de l’exportation des solutions d’IA développées aux Émirats arabes unis.
Avec ce mémorandum, Libreville et Presight posent les bases d’une coopération appelée à se préciser dans les prochains mois. La signature d’accords opérationnels permettra de définir le périmètre exact des projets, les modalités de mise en œuvre ainsi que les investissements associés, dans un contexte où le Gabon cherche à structurer une stratégie numérique plus cohérente et mieux alignée sur ses priorités de modernisation de l’État.
Samira Njoya
Edité par Sèna D. B. de Sodji
More...
Confronté au sous-emploi des jeunes, le Kenya mise sur l’externalisation pour créer des emplois numériques et séduire les investisseurs, avec l’ambition de devenir une référence africaine des services aux entreprises.
Dans une démarche inédite, quatre opérateurs majeurs de l’externalisation des services aux entreprises ont lancé cette semaine « The Outsourcing Alliance of Kenya » (OAK). Cette coalition privée vise à structurer et accélérer le développement des Global Business Services, incluant le BPO et les services informatiques externalisés. L’annonce a été faite le jeudi 5 février par le ministère de l’Information, des Communications et de l’Économie numérique sur son compte X, marquant une nouvelle étape pour un secteur appelé à jouer un rôle central dans la création d’emplois.
𝐊𝐞𝐧𝐲𝐚'𝐬 𝐆𝐥𝐨𝐛𝐚𝐥 𝐁𝐮𝐬𝐢𝐧𝐞𝐬𝐬 𝐒𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐞𝐬 𝐒𝐞𝐜𝐭𝐨𝐫 𝐑𝐞𝐚𝐜𝐡𝐞𝐬 𝐍𝐞𝐰 𝐌𝐢𝐥𝐞𝐬𝐭𝐨𝐧𝐞𝐬 𝐰𝐢𝐭𝐡 𝐋𝐚𝐮𝐧𝐜𝐡 𝐨𝐟 𝐎𝐮𝐭𝐬𝐨𝐮𝐫𝐜𝐢𝐧𝐠 𝐀𝐥𝐥𝐢𝐚𝐧𝐜𝐞
— Ministry of Info, Comms & The Digital Economy KE (@MoICTKenya) February 5, 2026
The Outsourcing Alliance of Kenya (OAK) was officially launched on February 3, 2026, signaling… pic.twitter.com/NjaNNt3g7M
Le lancement officiel s’est déroulé en présence de représentants du gouvernement. Selon Kenyan Wall Street, l’alliance regroupe notamment CCI Kenya, CloudFactory Kenya, Teleperformance Kenya et Sama Kenya. Elle ambitionne de fédérer plus de vingt membres d’ici au deuxième trimestre 2026 et de contribuer à la création de 100 000 emplois sur l’ensemble de la chaîne de valeur.
Le secrétaire principal chargé des TIC et de l’Économie numérique, John Tanui, a rappelé dans un discours lu lors de l’événement que l’expansion des Global Business Services constitue un levier pour offrir des opportunités inclusives aux jeunes. Il a souligné le rôle catalyseur de l’État à travers des politiques ciblées, des cadres réglementaires adaptés et des mesures facilitant l’accès aux marchés internationaux. Le gouvernement s’appuie notamment sur des programmes de formation comme Ajira Digital et Jitume, qui visent à former massivement les jeunes Kényans aux compétences recherchées par le marché mondial de l’outsourcing, selon le ministère de l’Économie numérique.
Cette initiative intervient alors que le Kenya enregistre un taux de chômage d’environ 5,2 % en 2025, avec une situation particulièrement difficile pour les jeunes. Dans le même temps, la pénétration d’internet atteint 48 % en 2025, un taux encore perfectible, mais en nette progression, qui constitue un facteur déterminant pour le développement des services numériques et de l’outsourcing.
Félicien Houindo Lokossou
Edité par Sèna D. B. de Sodji
Lire aussi:
Kenya : le Trésor déploie une plateforme numérique pour la gestion de la dette extérieure
Malgré leur popularité auprès du public, de nombreux artistes ivoiriens tirent peu de revenus de la diffusion numérique de leurs œuvres. Les autorités entendent corriger cette situation en structurant la monétisation des contenus numériques, afin de garantir une rémunération plus équitable.
Le gouvernement ivoirien a annoncé sa volonté de faire de la monétisation des contenus numériques une réalité à l’horizon 2026, en réponse aux attentes des acteurs de la culture, de la musique et des médias. La ministre de la Culture et de la Francophonie, Françoise Remarck, a engagé, le lundi 2 février, des discussions avec la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle (HACA) ainsi que plusieurs partenaires du secteur, afin de définir des mécanismes de valorisation des contenus numériques produits localement.
Concrètement, la démarche vise à mettre en place un cadre réglementaire et opérationnel permettant de capter et de redistribuer une part significative des revenus issus de l’écoute en ligne, du streaming musical, de la vidéo et des contenus audiovisuels. L’exécutif entend ainsi structurer un écosystème dans lequel les plateformes numériques, locales comme internationales, rémunèrent les artistes et créateurs selon des règles claires, tout en renforçant la régulation des droits d’auteur et des contrats de distribution.
La question revêt une dimension économique croissante. Selon le « Global Music Report 2025 » de la Fédération internationale de l’industrie phonographique (IFPI), l’Afrique subsaharienne a enregistré en 2024 une croissance de 22,6 % des revenus de la musique enregistrée, atteignant un niveau record de 110 millions USD, soit près de cinq fois la croissance mondiale, estimée à 4,8 % sur la même période.
En Côte d’Ivoire, les plateformes de streaming musical telles que Boomplay, Spotify, Apple Music ou Deezer gagnent progressivement du terrain. Les modèles de rémunération varient toutefois selon les plateformes et les marchés. À titre indicatif, un million d’écoutes sur Spotify peut générer environ 1,2 million FCFA (environ 2155 USD) pour les ayants droit, illustrant le potentiel économique du streaming, mais aussi les écarts persistants de revenus.
Malgré une audience numérique en expansion, la monétisation demeure limitée pour de nombreux artistes d’Afrique francophone. Une part importante de la valeur créée continue d’échapper aux créateurs locaux, en raison de structures contractuelles peu favorables et de cadres réglementaires encore insuffisamment adaptés aux réalités du numérique.
L’initiative ivoirienne s’inscrit, par ailleurs, dans un contexte plus large de développement de l’économie numérique nationale. Le pays dispose d’une infrastructure mobile relativement solide. Au premier trimestre 2025, le taux de couverture 4G atteignait 76,88 %, facilitant l’accès aux services numériques et aux plateformes de diffusion de contenus.
En structurant la monétisation des contenus numériques, Abidjan cherche à intégrer davantage l’économie créative dans le secteur formel, à renforcer les revenus des artistes et producteurs locaux et à positionner la culture numérique comme un levier de croissance économique et d’emplois, alors que les marchés du streaming et des contenus numériques poursuivent leur dynamique d’expansion sur le continent africain.
Samira Njoya
Lire aussi:
Contenus numériques africains : vers une industrie à 30 milliards USD en 2032
Partenaire de Zipline depuis près d’une décennie, le Rwanda a été l’un des premiers pays au monde à adopter la livraison autonome par drone. Cette collaboration historique prend désormais une nouvelle dimension, avec l’élargissement des usages et de la couverture du service.
Le Rwanda a signé, le jeudi 6 février, un accord d’expansion stratégique avec Zipline afin de devenir le premier pays au monde à disposer d’un réseau national de livraison autonome par drones, incluant le tout premier réseau urbain de livraison par drone en Afrique. Cet accord intervient dans le cadre de la subvention de 150 millions de dollars accordée à Zipline par le Département d’État américain, dont le Rwanda est le premier bénéficiaire.
« Le Rwanda et Zipline travaillent ensemble depuis des années pour exploiter la technologie au service de notre peuple. Nous avons été témoins de l’impact extraordinaire de la livraison par drone – économiser du temps, économiser de l’argent et sauver des vies. Grâce à ce partenariat, nous allons désormais étendre la livraison urbaine, en apportant ces avantages à encore plus de collectivités », a déclaré Paula Ingabire, ministre rwandaise des TIC et de l’Innovation.
Concrètement, le Rwanda sera le premier pays africain à déployer le système de livraison urbaine de Zipline, Platform 2 (P2). Cette technologie permet des livraisons rapides, silencieuses et extrêmement précises dans des environnements urbains denses comme Kigali, qui concentre à elle seule près de 40 % de la demande nationale de soins de santé. La plateforme est déjà utilisée aux États‑Unis pour livrer des dizaines de milliers de produits de détail et alimentaires directement à domicile ou dans des espaces publics.
L’accord prévoit également le renforcement du réseau existant avec l’ouverture d’un troisième centre de distribution longue distance dans le district de Karongi, en complément des hubs de Muhanga et Kayonza. Cette nouvelle infrastructure permettra d’étendre les livraisons au‑delà de la forêt de Nyungwe, notamment vers les districts frontaliers de la République démocratique du Congo, améliorant ainsi l’équité territoriale dans l’accès aux produits médicaux essentiels.
Au‑delà de la logistique, Zipline ambitionne d’installer au Rwanda son premier centre international d’essais dédié à l’intelligence artificielle et à la robotique. Ce centre de recherche et développement servira à tester de nouveaux systèmes de sécurité, des logiciels logistiques de nouvelle génération et les performances des aéronefs dans diverses conditions climatiques. Il vise également la formation de talents locaux et la création d’emplois hautement qualifiés dans les technologies avancées.
Ce nouvel accord s’inscrit dans une coopération de long terme entre le Rwanda et Zipline. Présente dans le pays depuis 2016, la société américaine a vu son partenariat renouvelé à plusieurs reprises, dont un contrat de 61 millions de dollars signé en décembre 2022. Celui‑ci prévoit l’extension des sites de livraison en zones rurales et urbaines, avec l’objectif de tripler les volumes et d’atteindre près de 2 millions de livraisons d’ici 2029, pour plus de 200 millions de kilomètres parcourus par des drones autonomes.
Selon les données communiquées par l’entreprise, cette collaboration avec Zipline a contribué à une baisse de 51 % de la mortalité maternelle dans les zones couvertes. Par ailleurs, l’intégration en temps réel des données de livraison dans les systèmes nationaux de santé et d’urgence a permis de renforcer la capacité de surveillance épidémiologique et la réactivité face aux crises sanitaires.
Samira Njoya
Lire aussi:
Zipline renouvelle et étend son partenariat de livraison par drones au Rwanda
Face à la pénurie de médecins et à la demande croissante de soins spécialisés, l’Afrique explore la chirurgie robotique pour optimiser les compétences disponibles. Le Maroc, en multipliant les initiatives, entend se positionner à l’avant-garde de cette révolution médicale sur le continent.
Le jeudi 29 janvier, le Maroc a inauguré ses premiers services publics de chirurgie robotique au Centre hospitalier universitaire (CHU) Mohammed VI d’Agadir, avec les premières interventions assistées par robot réalisées dans un établissement public. Cette annonce est survenue la veille de l’inauguration, à Casablanca, de la Mohammed VI Interventional Simulation and Robotic Surgery School (M6 ISRSS), école dédiée à la formation en chirurgie robotique et en simulation interventionnelle. Ces deux initiatives successives illustrent une stratégie nationale visant à moderniser le système de santé et à réduire les disparités régionales en matière d’accès aux soins spécialisés.
Un déficit de médecins qui pèse sur l’offre de soins spécialisés
Cette démarche répond à un déficit structurel de médecins et de chirurgiens. En 2023, le royaume affichait une densité médicale de 7,8 à 7,9 médecins pour 10 000 habitants, inférieure au seuil critique de 2,5 médecins pour 1000 habitants recommandé par l’Organisation mondiale de la santé (OMS). En 2025, le ministère de la Santé a estimé le besoin supplémentaire en ressources humaines à plus de 96 000 professionnels, dont 32 000 médecins et 64 000 infirmiers, afin de faire face à la demande croissante de soins spécialisés.
L’introduction de la chirurgie robotique vise à compenser partiellement cette pénurie en optimisant l’utilisation des compétences existantes. Les systèmes robotisés permettent aux chirurgiens d’intervenir avec une précision accrue et ouvrent la voie à des modèles d’intervention à distance et de supervision inter-hospitalière, rendus possibles par des infrastructures numériques fiables.
Le Maroc a déjà démontré sa capacité à opérer à distance. En 2024, une prostatectomie radicale a été réalisée entre Casablanca et Shanghai, à plus de 12 000 km. L’année suivante, une nouvelle téléchirurgie a été menée avec succès entre Casablanca et Tanger, confirmant la faisabilité technique de ces interventions au niveau national.
Un marché mondial en forte croissance
L’investissement marocain s’inscrit dans un contexte mondial de forte expansion de la chirurgie robotique. Selon Mordor Intelligence, le marché mondial est estimé à 8,31 milliards USD en 2025 et devrait atteindre 12,83 milliards USD d’ici 2030, avec un taux de croissance annuel moyen de 9,07 %. Cette croissance est portée par la demande des populations vieillissantes pour des interventions moins invasives et plus précises, ainsi que par la consolidation hospitalière favorisant les plateformes de chirurgie à forte utilisation. En Afrique, le marché reste dominé par l’Afrique du Sud et l’Égypte, mais le Maroc pourrait en profiter grâce à ses nouvelles infrastructures et à l’expertise croissante de ses équipes médicales.
Un investissement stratégique pour le pays
Le projet de robot chirurgical Revo-i au CHU d’Agadir représente un investissement public de 26,35 millions de dirhams (≈ 2,9 millions USD). Il s’inscrit dans une stratégie visant à rapprocher les soins spécialisés des citoyens, à réduire les déplacements médicaux et à renforcer l’offre régionale et nationale. La plateforme sert également de centre de formation et de supervision pour les équipes hospitalières, garantissant un déploiement progressif et sécurisé de la technologie.
Le lancement de la M6 ISRSS complète cette démarche. L’école propose le premier diplôme universitaire de chirurgie robotique, couvrant plusieurs spécialités : urologie, chirurgie générale, gynécologie et chirurgie thoracique, et forme des chirurgiens et techniciens capables de maintenir un niveau homogène de qualité des soins, même lorsque les compétences spécialisées ne sont pas disponibles localement. Cette approche permet aussi d’améliorer l’attractivité des carrières hospitalières et de limiter la fuite des talents vers le secteur privé ou l’étranger.
Si la chirurgie robotique ne peut à elle seule combler le déficit de médecins et d’infirmiers, elle constitue un levier stratégique pour moderniser l’offre de soins spécialisés. En combinant investissement technologique, formation avancée et premières expérimentations de téléchirurgie, le Maroc cherche à bâtir un système de santé plus résilient, capable d’absorber les tensions liées à la pénurie de praticiens tout en s’alignant sur les standards internationaux.
Samira Njoya
Lire aussi:
Maroc : trois accords signés pour renforcer l’offshoring numérique